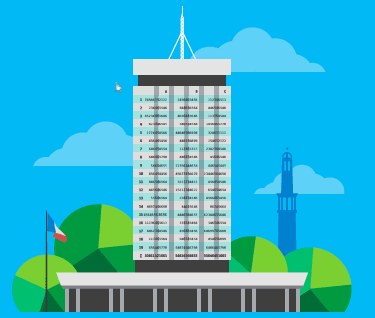
Réponse à un “livre noir” qui noircit beaucoup et éclaire peu.
Il existe une tradition grenobloise tenace : inventer régulièrement une Grenoble imaginaire– idéale ou infernale. Deux récits s’affrontent. Celui d’une ville inventive, diverse, culturelle, joyeuse, parfois contradictoire. Et celui, fantasmé, d’une ville apocalyptique, régulièrement dépeinte par l’équipe d’Alain Carignon, qui aime projeter sur la ville un scénario catastrophe digne d’une mauvaise série télé.
Une production récente du site Grenoble le Changement – « Culture : le livre noir des Verts/LFI à Grenoble » – relève clairement de la seconde catégorie : une épopée ténébreuse où, depuis 2014, Grenoble serait devenue un territoire où la culture agonise, les bibliothèques ferment en chaîne et les artistes muselés fuiraient en hurlant sur fond de violons brisés, remplacés par des vélos-cargos. Rien ne nous est épargné : hyperboles, anachronismes, raccourcis, amalgames, citations tronquées, nostalgie d’un “avant” mythifié.
Rappelons, s’il était nécessaire, que Grenoble le Changement, outil de propagande conçu pour attaquer la majorité, n’a pas pour objectif de comprendre les politiques publiques mais de les discréditer. Instrument de communication politique au service d’Alain Carignon, le site s’est spécialisé depuis des années dans les campagnes de dénigrement, les contre-vérités et l’instrumentalisation des peurs.
Or rien, dans l’histoire ou les propositions de M. Carignon – ancien maire condamné pour corruption et aujourd’hui soutenu par une droite dure plus prompte au coup médiatique qu’à la construction – ne permet de penser qu’il serait en mesure de porter aujourd’hui une politique culturelle crédible. Lui dont l’implication culturelle fut aussi discrète que son passé judiciaire a été médiatisé. On peut donc s’étonner de le voir distribuer aujourd’hui les bons et mauvais points de la politique culturelle grenobloise.
Puisque la vraie Grenoble existe aussi, elle mérite mieux que cette caricature spectaculaire, éloignée des réalités culturelles, financières et institutionnelles des dix dernières années.
Tentons donc un exercice simple : regarder les faits, avec des sources et un minimum de rigueur, pour les remettre dans leur contexte. Ni enfer ni paradis, Grenoble est avant tout une ville où la culture se construit depuis longtemps, à travers un tissu associatif dense, une tradition d’éducation populaire et un engagement citoyen très ancré.
1. Grenoble, une culture vivante – ni miracle, ni désert
S’il est une ville où la culture s’est construite sur un socle puissant – tissu associatif dense, tradition d’éducation populaire, vivacité des mouvements citoyens, présence de la recherche et de l’innovation – c’est bien Grenoble. Cette vitalité existe depuis des décennies, façonnée autant par les politiques publiques (Dubedout en premier lieu) que par une vie associative puissante.
Contrairement au récit proposé dans l’article, Grenoble n’est pas devenue un désert culturel depuis l’arrivée de la majorité portée par Éric Piolle. Les deux mandats n’ont pas été exempts de difficultés, marqués par des décisions perçues parfois comme brutales et un dialogue trop heurté avec certains acteurs culturels. Ces critiques sont connues et il serait absurde de les nier.
Quelques repères permettent de sortir des caricatures :
- Une décentralisation culturelle précoce, et surtout un héritage Dubedout
Si Grenoble n’est pas la première ville à avoir obtenu une “Maison de la Culture”[1], la construction de l’équipement inauguré en 1968, devenu “MC2” depuis 2004, montre que la ville a pris très tôt le train de la décentralisation culturelle. C’est cependant à partir des années Dubedout (1971–1983) que Grenoble adopte une politique culturelle audacieuse, sociale, associative, ancrée dans les quartiers – un héritage structurant que la droite locale oublie volontiers lorsqu’elle s’improvise gardienne de la mémoire culturelle grenobloise. - Une reconnaissance patrimoniale récente
Grenoble est devenue Ville d’art et d’histoire en 2017, confirmation institutionnelle de son patrimoine urbain, architectural et social. - Une vie culturelle dense et partagée
Le bassin grenoblois accueille entre 70 et 100 festivals par an, preuve d’une vitalité culturelle qui ne dépend ni d’une majorité municipale unique, ni d’un récit apocalyptique. - Une tradition d’innovation et d’éducation populaire
Grenoble, ville de savoirs, de recherche, de pratiques sociales et militantes (de l’éducation populaire au planning familial), a toujours généré une effervescence culturelle qui dépasse largement les seules institutions.
- Un écosystème associatif exceptionnel
Associations, collectifs, artistes, salles indépendantes, lieux alternatifs, tiers-lieux et initiatives citoyennes forment un paysage culturel diversifié et résilient – qui doit autant à l’histoire locale qu’aux politiques publiques.
2. Ce que l’article de Grenoble le changement, oublie soigneusement : le contexte financier réel
Beaucoup est reproché, mais rien n’est contextualisé.
Or quelques faits incontournables suffisent à nuancer le récit :
- En 2014, Grenoble hérite de 120 millions d’euros de dette.[2]
- Entre 2014 et 2017, les communes françaises subissent une chute historique des dotations de l’État.[3]
- Grenoble doit maintenir ses services publics culturels sans hausse massive d’impôts – comme la plupart des villes.[4]
- Les compétences culturelles sont partagées entre Ville, Métropole, Département, Région et État – contrairement à ce que laisse croire l’article, qui accuse la mairie comme si elle gouvernait seule tout le secteur. Un raccourci commode et trompeur.
3. Fact-checking tranquille (mais nécessaire)
L’article déroule une série de drames culturels dignes d’un opéra.
Reprenons-les ici.
Les Musiciens du Louvre : non, ils n’ont pas été “chassés ». Mais la méthode a laissé des traces.
Soutien réduit, oui. Exil forcé, non.
La suppression de la subvention municipale n’a pas mis l’orchestre en péril. D’une part, son budget global (+ de 3,7M€ en 2014) repose essentiellement sur des financements nationaux et régionaux, la part municipale étant marginale (438K€). D’autre part, la Ville a continué à héberger gratuitement l’orchestre. Les Musiciens du Louvre ont d’ailleurs continué à se produire régulièrement à Grenoble après 2014.
Cela n’efface pas pour autant les difficultés de cette séquence. La décision a été brutale, mal expliquée, et a donné l’impression d’un désengagement soudain envers une institution emblématique. Elle a inquiété une partie du secteur culturel et nourri des incompréhensions durables. Ce n’est pas l’effondrement décrit par l’article de Carignon, mais c’est sans doute un moment où la communication, la méthode et l’écoute ont clairement manqué.
Dit autrement, les Musiciens du Louvre n’ont pas été “chassés”, mais cet épisode a révélé une difficulté réelle du premier mandat à accompagner des arbitrages complexes sans créer d’inquiétude inutile dans le milieu culturel.
Les bibliothèques Prémol et Hauquelin : une décision vécue comme un traumatisme
Oui, deux bibliothèques de quartier ont fermé en 2016, dans un contexte de crise financière majeure.
Il faut le dire clairement : cette décision a été brutale, mal préparée, mal expliquée, et a profondément marqué de nombreux Grenoblois·es. Pour beaucoup d’habitant·es, surtout dans les quartiers populaires, ces bibliothèques représentaient bien plus qu’un équipement culturel : un repère, un lieu de proximité, un symbole de présence publique.
Mais reconnaître ce traumatisme ne doit pas conduire au récit d’effondrement général du réseau, comme le fait l’article de Carignon.
Les faits sont les suivants :
- Grenoble reste l’une des villes les mieux dotées en bibliothèques par habitant.
- Depuis 2017, le réseau a été modernisé, avec des horaires élargis, de nouveaux services, une meilleure accessibilité.
- Depuis 2019, le réseau est totalement gratuit pour tous les usagers.[5]
- Le plan lecture 2018-2025, malgré un contexte budgétaire très contraint, a consolidé plusieurs équipements et renforcé l’accès aux collections, numériques comme physiques.[6]
Le CIEL : une structure fragile bien avant 2014
La salle emblématique des musiques actuelles grenobloises, Le Ciel, connaissait depuis longtemps de sérieux dysfonctionnements. La Régie 2C, gestionnaire historique, a été liquidée en 2016. Le Ciel a rouvert en 2019 sous la gestion de l’association Plege, avec un projet repensé (résidences, espaces de répétitions, concerts et tiers-lieu). Entre temps, La Belle Électrique a été inaugurée en 2015, et le secteur des musiques actuelles a été réorganisé sur le territoire. Il s’agit d’une évolution de modèle, pas d’une disparition.
Le Magasin : une crise ancienne, structurelle, nationale, pas grenobloise
Oui, le Magasin, Centre national d’art contemporain grenoblois, connaît des crises depuis longtemps, avant comme après 2014.
La DCA, réseau des centres d’art, alerte depuis des années sur la baisse des financements, la rotation rapide des directions et le manque de stabilité institutionnelle.[7]
La Ville n’a jamais retiré son soutien : elle a maintenu sa subvention, mis le bâtiment à disposition du centre d’art et participé, avec la DRAC et les partenaires, à la refondation du projet “Magasin des Horizons”.
Les difficultés du lieu relèvent avant tout d’une fragilité structurelle nationale du modèle des centres d’art, documentée par la DCA, et non d’un désengagement municipal.
Le budget culturel amputé entre 2017 et 2019 : un arbitrage sous contrainte nationale
Il faut rappeler qu’il s’agit d’une période où toutes les villes françaises ont subi la plus forte chute de dotations d’État depuis les années 1980. Cette baisse doit être replacée dans son contexte :
- baisse massive des dotations d’État,
- obligations légales de redressement,
- choix de préserver les secteurs sociaux, éducatifs et de transition écologique.
Malgré ces conditions exceptionnelles, Grenoble demeure au-dessus de la moyenne nationale en dépenses culturelles par habitant[8].
Le “désengagement idéologique” est donc un récit simpliste.
La charte culturelle “idéologique » : un récit commode
Présentée comme un instrument de contrôle politique, elle s’inscrit en réalité dans un mouvement national bien documenté : depuis 2016, l’État, les Régions, les Métropoles et la plupart des grandes villes françaises conditionnent leurs subventions culturelles à des engagements en matière d’accès aux droits culturels, de diversité, d’éco-responsabilité ou de mixité.La charte grenobloise[9] applique les cadres:
- de la loi LCAP (2016),
- de la loi NOTRe (2015) sur les droits culturels,
- des orientations nationales, régionales et européennes.
Rennes[10], Nantes[11], Paris[12], Lyon, Strasbourg… Toutes fonctionnent avec des chartes similaires, souvent co-construites. Parler de censure relève de l’effet de manche.
4. Ce qui a réellement été fait (et ne mérite pas un livre noir)
Contrairement à ce récit alarmiste, les données publiques montrent une politique culturelle grenobloise maintenue, structurée et accessible, malgré un contexte budgétaire national extrêmement contraint.
- Un budget culturel stabilisé à un niveau élevé : Grenoble consacre encore plus de 30 M€ par an à la culture[13], soit 196 €/habitant en 2024, un niveau stable depuis plusieurs années malgré la chute historique des dotations d’État. C’est bien au-dessus de la moyenne nationale des dépenses culturelles locales (156 €/habitant).[14]
- Un effort important sur l’accès pour tous : gratuité totale des bibliothèques pour tous les usagers (2019), gratuité du Musée de Grenoble pour les collections permanentes (2023).
- Une politique alignée sur les droits culturels et les cadres nationaux : application de la loi LCAP 2016, des droits culturels, inscrits dans la Loi NOTRe adoptée en 2015, des cadres du ministère, de la Région et de l’Union européenne.
- Un paysage culturel vivant : bibliothèques municipales, salles indépendantes, lieux associatifs, équipements métropolitains, structures départementales… L’ensemble du paysage culturel grenoblois est bien vivant, actif et fréquenté.
Voir aujourd’hui cette même droite dure et l’ancien maire condamné pour corruption se présenter en garants de la culture grenobloise laisse perplexe. Leur vision est celle d’une culture réduite à un outil d’image et de communication politique.
Conclusion : la culture mérite mieux que les livres noirs
… et mieux que les régressions qui s’annoncent.
On peut, on doit débattre de la politique culturelle grenobloise. Mais ce débat mérite des faits, non des fictions, surtout à un moment où le secteur culturel français traverse l’une des crises les plus profondes de son histoire[15] :
- coupes et baisses historiques des budgets dans de nombreuses collectivités,
- fragilisation des festivals, des événements, du spectacle vivant, des actions d’éducation artistique et culturelle,
- précarité grandissante des artistes et des structures indépendantes,
- menaces croissantes sur la diversité culturelle et la liberté de création.
Dans ce contexte, une autre réalité s’impose : la progression de l’extrême-droite en France fait peser une menace directe sur la liberté artistique, la pluralité des expressions, l’indépendance des institutions. Face à cela, les villes ont une responsabilité particulière.
Grenoble peut rester un territoire où la culture demeure un espace de liberté, de rencontre et d’émancipation – une ville où l’on protège la diversité des pratiques et des expressions culturelles, plutôt que de les réduire ou les contrôler.
Les cultures, au pluriel, sont le ciment de la société, la fabrique de la relation, de la compréhension, de la nuance. Et nous en avons besoin.
Tenir ce cap implique aussi de regarder avec lucidité les deux mandats qui s’achèvent. Ils n’ont pas été parfaits. Certaines décisions ont été mal accompagnées, des méthodes ont manqué, des tensions ont été mal gérées. Le premier mandat a laissé des traces et il serait inutile de le nier.
La ville n’a ni sombré ni rayonné de manière exceptionnelle. Comme pour tout, à l’avenir elle pourra et devra faire mieux.
2026 doit ouvrir un cycle différent : plus collaboratif, plus stable, plus exigeant.
Une étape où les futures listes seront attendues sur des engagements concrets et un changement de méthode :
- plus de concertation,
- plus de stabilité,
- plus de clarté dans les priorités,
- plus d’attention aux quartiers,
- et un soutien affirmé à la création, aux artistes, aux associations et aux lieux indépendants.
Une ville qui soutient la culture, qui garantit à chacun·e la possibilité de participer, créer, prendre part pleinement à la vie culturelle, qui défend la création et protège ses lieux et ses artistes.
Grenoble dispose des ressources, des acteurs et de l’histoire nécessaires pour écrire une nouvelle page culturelle ambitieuse. Ce dont la Ville a besoin aujourd’hui, ce n’est ni d’un livre noir, ni de promesses incantatoires : c’est d’un projet lisible, co-construit, stable et protecteur de toutes les formes de création.
C’est cela, l’enjeu des élections municipales de 2026.
[1] 1961 : inauguration au Havre de la première Maison de la Culture de France, sous l’impulsion d’André Malraux.
[2] Sources : rapports de la Chambre Régionale des Comptes (CRC Auvergne-Rhône-Alpes, 2018 & 2021).
[3] Source : Ministère des Finances publiques – DGF en baisse cumulée nationale de 11 milliards d’euros.
[4] Selon le baromètre 2025 de l’Observatoire des politiques culturelles (OPC), « le “bloc local” (communes, métropoles, communautés urbaines) … maintient majoritairement son soutien [à la culture] » in Le Monde.fr
[5] Auvergne Rhône-Alpes Livre & Lecture
[7] « une succession de crises à Grenoble, mais aussi une fragilité nationale du modèle » Source Le Monde
[8] Source DEPS, Statistiques culturelles 2025, Les dépenses culturelles des collectivités territoriales en 2023 et leur évolution depuis 2019
[9] « Elle s’intègre pleinement dans les dispositions de la loi de 2016 relatives à la liberté de création, ainsi que celles de la loi Notre relative aux droits culturels. » Préambule de la Charte culturelle des transitions de Grenoble
[10] Charte des engagements réciproques de la Ville de Rennes.
[11] Charte d’engagements mutuels de la Ville de Nantes
[12] Charte d’engagements réciproques de la Ville de Paris
[13] Source Grenoble Culture[s] 2026
[14] Source Ministère de la Culture
