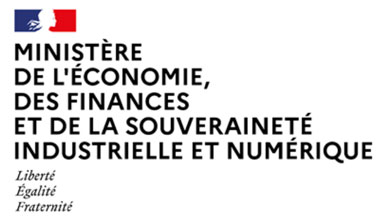
L’inspection générale des finances (IGF) avait rendu en octobre 2023 un rapport confidentiel sur l’investissement des collectivités. Ce rapport avait été commandé le 26 juin 2023 par la Première ministre de l’époque qui avait la responsabilité de la planification écologique. Le nouveau gouvernement est en train d’abandonner cette planification en se concentrant uniquement sur les diminutions des dépenses de l’Etat et des collectivités, sans rechercher de nouvelles recettes indispensables à la réalisation des investissements nécessaires à la transition climatique.
L’IGF évalue à 21 milliards d’euros par an l’investissement que devront consacrer les collectivités territoriales à la transition écologique d’ici à 2030. Elles devraient dégotter 15 milliards d’euros pour la réduction des gaz à effet de serre et 6 milliards d’euros pour « l’adaptation au changement climatique et la préservation de la qualité de vie et des écosystèmes ».
Représentant un tiers des investissements totaux, le poste de dépenses le plus coûteux serait celui de la rénovation énergétique des bâtiments avec 7 milliards d’euros par an. Suivent quatre autres postes dont le coût se situe entre 2,2 et 2,6 milliards d’euros : les pistes cyclables, le transport ferroviaire, les réseaux d’eau et d’assainissement ou encore le recyclage des friches et la renaturation.
Il y a peut-être actuellement des investissements à diminuer sur les 54 milliards d’euros investit par an par les collectivités, mais certainement très peu pour couvrir les 21 nouveaux milliards. De son côté, la ville de Grenoble a décidé d’augmenter ses investissements grâce au bouclier social et climatique. La Métro avait programmé une programmation pluriannuelle d’investissement jusqu’en 2030 qui marquait une évolution dans le bon sens, mais l’inflation sur les coûts des investissements est en train de réduire notamment des investissements liés à la transition climatique par manque de recettes de fonctionnement pour maintenir une épargne suffisante pour éviter un trop important appel à l’endettement. La Métro devrait choisir de diminuer plutôt les investissements non essentiels à la transition.
Voici la synthèse du rapport de l’IGF :
« Les collectivités territoriales ont conforté ces dernières années leur place de premier investisseur public, à hauteur de 58 % du total. Leurs dépenses d’équipement, investissements dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage, représentent 54 Md€ en 2022, dont le bloc communal porte les deux tiers.
L’État est le principal cofinanceur de cet effort, avec plus de 9,8 Md€ en 2022, au bénéfice en particulier des communes et des EPCI. Les financements de l’État sont en hausse de 21 % par rapport à 2018, et devraient être amenés à progresser encore avec le « fonds vert » créé en 2023 et abondé dans le projet de loi de finances pour 2024.
Les collectivités et l’État sont donc solidaires face aux trois défis posés par l’investissement :
assurer le renouvellement du dense réseau d’équipements des collectivités territoriales ;
faire face aux lourds investissements qu’exige la transition écologique, avec une estimation, pour les collectivités, de 21 Md€ par an d’ici 2030 pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation de leurs territoires au changement climatique ;
concilier cohérence de l’action publique, équilibre nécessaire des comptes publics et principe de libre administration des quelque 45 200 collectivités, EPCI et syndicats.
La situation financière du plus grand nombre de collectivités, analysée en 2022, est favorable. Elle leur permet de mobiliser plusieurs leviers pour financer leurs investissements 1 :
l’autofinancement : leur trésorerie a atteint en 2022 un niveau historique de 65,7 Md€, en hausse de près de 25 Md€ depuis 2015, et le taux d’épargne du bloc communal et des départements s’est amélioré ;
la réorientation de certaines dépenses. La mission a identifié des possibilités liées à trois transitions : la transition climatique, qui invite à réduire les dépenses dites « brunes » ou négatives pour l’environnement, la transition démographique, pour prendre en compte la diminution de la population scolaire, et la transition numérique, qui ouvre la possibilité d’optimiser le bâti administratif ;
l’endettement : celui des communes, des EPCI, des syndicats et des départements a diminué depuis 2015, ce qui leur donne des marges de manœuvre, dans un contexte toutefois marqué par la hausse des taux d’intérêt et le besoin global de désendettement des administrations publiques.
L’année 2023 a cependant introduit des inquiétudes, relatives à la moindre croissance de la TVA ou à la baisse des droits de mutation à titre onéreux, tandis que l’inflation et la hausse des taux d’intérêt renchérissent le coût de l’investissement.
Dans ce contexte plus incertain, les collectivités attendent d’abord de l’État une prévisibilité de leurs ressources et des soutiens à l’investissement qu’elles peuvent escompter, y compris en matière d’ingénierie, ainsi qu’une stabilité de la règle du jeu. A cet égard, une contractualisation substantielle, comprenant des engagements mutuels, notamment financiers, est une réponse à ce besoin.
S’agissant de la planification de la transition écologique, la circulaire du 29 septembre 2023 de la Première ministre fixe un cadre opérationnel : le niveau régional doit être l’échelon stratégique de répartition territoriale des objectifs nationaux de transition, et le niveau départemental est le lieu de synthèse de l’information, de programmation et d’arbitrage, y compris en ce qui concerne les opérateurs de l’État, pour la mise en œuvre des projets portés par le bloc communal. La nouvelle génération de contrats de réussite de la transition écologique (CRTE) devrait ainsi être l’occasion de donner aux collectivités une visibilité pluriannuelle sur les financements de l’État, et de fixer des objectifs de résultats en matière de transition écologique conjointement entre les collectivités et l’État.
En revanche le foisonnement des appels à projets de l’État et de ses opérateurs (près de 200 en 2022) décourage les petites et moyennes collectivités, imposant des délais de réponse qui ne sont pas nécessairement compatibles avec la réalisation des projets, avec des dossiers complexes à remplir, et risquant de perturber la cohérence des projets de territoire par des effets d’aubaine.
La mission préconise une stricte rationalisation, conduisant dans la plupart des cas à intégrer les enveloppes financières correspondantes dans les dotations de l’État.
Un travail partenarial dans trois domaines particuliers serait de nature à rendre l’investissement local plus efficace, et au meilleur coût :
en matière d’investissement, l’intercommunalité ne progresse plus depuis 2018 et représente 38 % des dépenses d’équipement du bloc communal. L’importance et la complexité de l’effort à conduire pour la transition écologique confirment cependant la pertinence de l’échelle intercommunale. C’est vrai particulièrement des bâtiments publics, dont la seule rénovation thermique est estimée à 7 Md€ par an ;
la responsabilité des exécutifs locaux, s’agissant d’investissements de long terme, ne se borne pas à la durée du cycle électoral, comme l’illustre la problématique des réseaux d’eau et d’assainissement, qui souffrent d’un sous-investissement chronique. La pratique comptable de l’amortissement, qui n’est que la traduction d’une responsabilité collective dans le temps, indispensable pour assurer le bon entretien et le renouvellement des équipements publics locaux, doit donc devenir le droit commun ;
le FCTVA, avec plus de 6,4 Md€ en 2022, représente les deux tiers des soutiens de l’État à l’investissement local. Sans ignorer la sensibilité du sujet, la mission recommande que soient examinées diverses pistes pour rendre le dispositif plus efficace, plus équitable, et plus incitatif au bénéfice des investissements « verts ».
Massifs, essentiels pour les citoyens comme pour notre économie, les investissements locaux sont paradoxalement mal connus. Les insuffisances des comptabilités patrimoniale et fonctionnelle, ainsi que l’absence d’une agrégation nationale des données appellent un effort d’information financière beaucoup plus précise.
De la même façon les dispositifs d’évaluation ex ante de la pertinence socio-économique et environnementale des investissements, et ex post de leur qualité, méritent d’être développés, en particulier quand le niveau d’investissement le justifie.
La généralisation de budgets verts, s’agissant de la priorité nationale donnée à la transition écologique, s’inscrirait dans cette exigence d’information, de compte rendu, et de mesure des progrès accomplis, à condition qu’une méthodologie soucieuse de simplicité soit harmonisée au plan national.
1 Outre le levier des recettes (fiscalité et tarifs) qui n’était pas dans le périmètre de la mission. »https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/Rapports%20de%20mission/2024/L’investissement%20des%20collectivit%c3%a9s%20territoriales_Version%20Web.pdf
Mots-clefs : collectivités, état, FInances
