 Jeudi 1er juin 17 h, manifestation contre la fermeture des bureaux de poste à Grenoble, organisée par le « collectif j’aime ma poste à Grenoble ». Départ devant la poste République (Maison du Tourisme) en direction de la grande poste boulevard Maréchal Lyautey pour y rencontre la direction de la poste. Pour signer la pétition cliquez ici.
Jeudi 1er juin 17 h, manifestation contre la fermeture des bureaux de poste à Grenoble, organisée par le « collectif j’aime ma poste à Grenoble ». Départ devant la poste République (Maison du Tourisme) en direction de la grande poste boulevard Maréchal Lyautey pour y rencontre la direction de la poste. Pour signer la pétition cliquez ici.
Archives du 26 mai 2017
Agenda
Bibliothèques : un débat ouvre des solutions à valider prochainement

© Ville de Grenoble
Le Conseil municipal du 22 mai a été marqué par un long débat (2h), serein et constructif, sur l’avenir de la lecture publique à Grenoble avec le collectif Touchez pas à nos bibliothèques. Ce collectif avait rassemblé 4 000 signatures dans le cadre du dispositif municipal d’interpellation citoyenne.
La lecture publique joue un rôle majeur à Grenoble, avec un réseau très dense et un personnel plus qualifié que dans la moyenne des villes, mobilisant plus du quart du budget culture. C’est ce qui explique la vigueur de la réaction citoyenne face aux décisions de regroupements de sites et de diminution de formats de 3 bibliothèques de quartier annoncées par la mairie dans le cadre du plan de sauvegarde des services publics locaux.
Après la nécessaire phase de vérification de la validité des signatures la Ville et les représentants du collectif ont dialogué pendant plusieurs semaines, sous la conduite de Corinne Bernard, adjointe aux cultures, pour trouver ensemble comment répondre aux besoins actuels des usagers et habitants, en cohérence avec le projet communal sur la lecture publique.
Les finances du SMTC en 2016 : fragiles
 Le Conseil syndical du SMTC a adopté le 18 mai le Compte Administratif 2016 (CA 2016) qui retrace la réalité des dépenses et des recettes du syndicat durant l’année 2016. La loi imposant que le compte administratif soit voté avant la fin du mois de juin de l’année suivante.
Le Conseil syndical du SMTC a adopté le 18 mai le Compte Administratif 2016 (CA 2016) qui retrace la réalité des dépenses et des recettes du syndicat durant l’année 2016. La loi imposant que le compte administratif soit voté avant la fin du mois de juin de l’année suivante.
L’année 2016 est la deuxième après la forte baisse des subventions décidée unilatéralement par le département (par l’ancienne majorité PS et suivie par la nouvelle majorité de droite). Pour atténuer cette baisse qui mettait en grand danger le SMTC, ce dernier a négocié une prise en charge d’une partie du remboursement de sa dette (315 M€) à égalité par les deux collectivités et ceci sur 10 ans. Chaque année la Métro et le département versent 15,75 M€ au SMTC en recette d’investissement pour éteindre cette dette en capital en 10 ans.
Le SMTC avait prévu de recevoir les 31,5 M€ en recettes de fonctionnement pour compenser la baisse des subventions, mais le comptable public a refusé. C’est dommage car cela aurait donné plus de souplesse de gestion au SMTC.
En ce qui concerne les recettes en fonctionnement, elles atteignent 161,5 M€, dont le versement transport (VT) pour 100, 8 M€ (2% de la mase salariale des organismes ayant plus de 10 salariés) et les collectivités (Métro et département) pour 56,5 M€ (rappel en 2014 c’était 73,5 M€).
Les usagers du service public des transports ont versé à la SEMITAG, 33,1 M€, en augmentation de 3,4% par rapport à 2015 (32 M€). La fréquentation du réseau est en augmentation passant de 85,7 millions de voyages à 87,7 millions due essentiellement à l’extension du réseau.
Caractéristiques de l’emploi des habitants de la métropole
 L’INSEE édite les résultats du dernier recensement (2013) sur les caractéristiques de l’emploi dans les différentes collectivités publiques. On y trouve la répartition en statut professionnel des 187 000 habitants ayant un emploi (salariés, CDI, CDD intérim, fonction publique, non salarié, indépendants, employeurs…), 90% des emplois sont des emplois de salarié.
L’INSEE édite les résultats du dernier recensement (2013) sur les caractéristiques de l’emploi dans les différentes collectivités publiques. On y trouve la répartition en statut professionnel des 187 000 habitants ayant un emploi (salariés, CDI, CDD intérim, fonction publique, non salarié, indépendants, employeurs…), 90% des emplois sont des emplois de salarié.
Le taux de travail partiel est beaucoup plus important pour les femmes 32,9% que pour les hommes 8,7 %. 34,7% de ceux qui ont un emploi travaillent dans leur commune de résidence et pour aller travailler, 59,9% utilisent la voiture, 19,5% les transports en commun, 8,9 % les deux roues et 8,9 % la marche à pied.
A partir du 1er novembre, les PACS se passeront à la mairie
 A partir du 1er novembre 2017, les pactes civils de solidarité (PACS) seront enregistrés par les officiers de l’état civil donc en général dans les mairies, suite à publication du décret du 6 mai 2017 en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle qui a confié aux officiers d’état civil des compétences dans le domaine de l’état civil précédemment exercées par les magistrats ou les greffiers.
A partir du 1er novembre 2017, les pactes civils de solidarité (PACS) seront enregistrés par les officiers de l’état civil donc en général dans les mairies, suite à publication du décret du 6 mai 2017 en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle qui a confié aux officiers d’état civil des compétences dans le domaine de l’état civil précédemment exercées par les magistrats ou les greffiers.
« Le décret modifie les dispositions réglementaires relatives aux PACS et au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, en prévoyant l’enregistrement et la gestion des déclarations, des modifications et des dissolutions de PACS par les officiers de l’état civil et, pour les partenaires de nationalité étrangère nés à l’étranger, par le service central d’état civil précité.
Il harmonise les dispositions relatives à l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions de PACS effectué par les officiers de l’état civil, les autorités diplomatiques et consulaires ainsi que les notaires. »
Le 20 avril 2017, l’association des Maires de France (AMF) a transmis un courrier à la Direction générale des collectivités locales pour indiquer que ce transfert à des officiers d’état civil qui vont agir au nom de l’Etat va impliquer de lourdes charges aux communes qui ne vont pas être compensées si l’on suit la jurisprudence et demande à l’Etat de faire tout de même un effort pour aider les communes.
Carte d’identité : on peut refuser la numérisation de ses empreintes digitales
 Depuis le 11 mai 2017 un décret permet de refuser la numérisation et l’enregistrement des empreintes digitales ; dans ce cas les empreintes sont recueillies sur papier. En effet le décret n° 2017-910 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de recueil et de conservation des empreintes digitales des demandeurs de carte nationale d’identité précise que le demandeur d’une carte d’identité peut « refuser la numérisation et l’enregistrement de ses empreintes digitales dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Titres électroniques sécurisés » (TES). Dans un tel cas, les empreintes sont recueillies sur le dossier papier de demande de carte nationale d’identité conservé par le service instructeur. »
Depuis le 11 mai 2017 un décret permet de refuser la numérisation et l’enregistrement des empreintes digitales ; dans ce cas les empreintes sont recueillies sur papier. En effet le décret n° 2017-910 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de recueil et de conservation des empreintes digitales des demandeurs de carte nationale d’identité précise que le demandeur d’une carte d’identité peut « refuser la numérisation et l’enregistrement de ses empreintes digitales dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Titres électroniques sécurisés » (TES). Dans un tel cas, les empreintes sont recueillies sur le dossier papier de demande de carte nationale d’identité conservé par le service instructeur. »
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) avait rendu un avis très critique sur cette conservation numérique le 16 mars 2017 en concluant : « Dans ces conditions, la Commission considère que la mesure envisagée, qui entraînera des conséquences contraires à l’objectif de simplification administrative sans pouvoir être justifiée par l’amélioration de la lutte contre la fraude documentaire, n’est pas de nature à réduire substantiellement les risques soulevés par la création de la base de données TES, dont la vocation demeure de réunir des données biométriques relatives à la quasi-totalité de la population française.
La Commission ne peut dès lors que réitérer les réserves exprimées dans sa délibération du 29 septembre 2016 relative aux conditions de mise en œuvre du traitement TES, et notamment celles tendant à ce que soient renforcées les mesures de sécurité visant à assurer la protection des données collectées. »
Les projets publics et leur empreinte carbone
 La loi sur la transition énergétique (du 17 août 2015) précisait que dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics doit intégrer, systématiquement et parmi d’autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En ce qui concerne les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics seront définis par un décret. C’est ce qui vient d’être précisé par le décret du 3 mai n° 2017–725 « relatif aux principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics ». C’est une approche qui prend en compte le « cycle de vie » : les phases de réalisation (y compris la phase d’études), de fonctionnement (exploitation, entretien, maintenance, réhabilitation) et de fin de vie du projet public (transformation y compris déconstruction et traitement des déchets des matériaux) sans oublier en amont la production des sources d’énergie et des matériaux et équipements nécessaires à chaque phase.
La loi sur la transition énergétique (du 17 août 2015) précisait que dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics doit intégrer, systématiquement et parmi d’autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En ce qui concerne les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics seront définis par un décret. C’est ce qui vient d’être précisé par le décret du 3 mai n° 2017–725 « relatif aux principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics ». C’est une approche qui prend en compte le « cycle de vie » : les phases de réalisation (y compris la phase d’études), de fonctionnement (exploitation, entretien, maintenance, réhabilitation) et de fin de vie du projet public (transformation y compris déconstruction et traitement des déchets des matériaux) sans oublier en amont la production des sources d’énergie et des matériaux et équipements nécessaires à chaque phase.
Le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques est arrêté
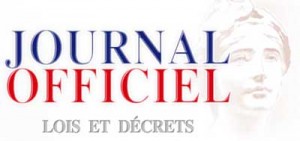 Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, la loi du 17 août 2015 imposait que le gouvernement fixe les objectifs de réduction des émissions anthropiques de polluants atmosphériques pour les années 2020 à 2024, 2025 à 2029, et à partir de 2030. Ces objectifs de diminution doivent être fixés par rapport au niveau des émissions de 2005.
Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, la loi du 17 août 2015 imposait que le gouvernement fixe les objectifs de réduction des émissions anthropiques de polluants atmosphériques pour les années 2020 à 2024, 2025 à 2029, et à partir de 2030. Ces objectifs de diminution doivent être fixés par rapport au niveau des émissions de 2005.
Ceci est précisé dans le récent décret (n° 2017-949 du 10 mai 2017) qui fixe les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques : dioxyde de soufre (SO2), oxydes d’azote (NOx), composés organiques volatils autres que le méthane (COVNM), ammoniac (NH3), particules fines (PM2,5).
Ces objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques doivent être maintenant pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ou dans les schémas régionaux et dans les plans de protection de l’atmosphère.
Diminutions des émissions par rapport aux émissions de l’année de référence 2005 :

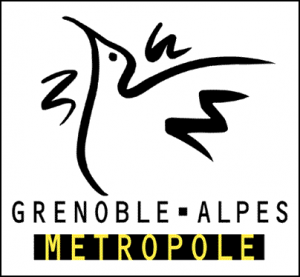 Par délibération du 16 décembre 2016, la Métropole a arrêté son projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) portant sur la période 2017-2022 ; il a été transmis pour avis aux 49 communes de la Métropole et à l’Etablissement Public du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Urbaine Grenobloise (EPSCOT) qui ont disposé d’un délai de deux mois pour se prononcer.
Par délibération du 16 décembre 2016, la Métropole a arrêté son projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) portant sur la période 2017-2022 ; il a été transmis pour avis aux 49 communes de la Métropole et à l’Etablissement Public du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Urbaine Grenobloise (EPSCOT) qui ont disposé d’un délai de deux mois pour se prononcer. Le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) consacre à son numéro d’avril 2017 sur consommation et cadre de vie une étude sur « E-administration : la double peine des personnes en difficulté ».
Le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) consacre à son numéro d’avril 2017 sur consommation et cadre de vie une étude sur « E-administration : la double peine des personnes en difficulté ».