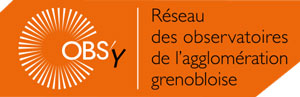Archives pour le mot-clef ‘social’
Publié le 27 février 2026
Le Réseau des collectivités territoriales pour une économie sociale et solidaire (RTES) propose son kit, composé d’une trentaine de fiches, il vise à outiller les équipes municipales et intercommunales dans leur politique de soutien à l’ESS (économie sociale et solidaire).
A quelques semaines des élections municipales, RTES propose aux élu.e.s, agent.e.s, et candidat.e.s, de découvrir des ressources, outils et expériences concrètes pour intégrer l’économie sociale et solidaire (ESS) dans leur politique municipale !
Proposer plus de repas bio et avec des produits locaux dans les cantines, réduire le gaspillage alimentaire, repenser la mobilité en proposant des plateformes de mobilité partagées et mixtes (vélo, covoiturage,…), renforcer l’autonomie énergétique à l’échelle d’une ville ou d’un territoire, avoir un service funéraire de qualité, impulser un habitat social innovant, créer des places en crèches ou des activités de centres de loisirs… autant de services qui doivent s’organiser sur un territoire et pour lesquels la collectivité a un rôle à jouer et des choix à faire : service marchand rendu par une entreprise classique, mise en régie et gestion directe par la collectivité, service rendu par une association, par un collectif, participation à une société coopérative… Mille façons, une multitude d’organisations existent pour rendre ces services. Ces choix ne sont pas neutres. Faire le choix de l’économie sociale et solidaire (ESS) permet d’accélérer la transition écologique, d’aller vers plus de justice sociale, d’améliorer le service public, et de permettre à la valeur ajoutée produite de dynamiser le territoire.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : économie, municipales 2026, social, solidarité
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 30 janvier 2026
À la date du 31 décembre 2024, il y avait à Grenoble 49 500 ménages allocataires de la Caisse d’allocation familiale (CAF), touchant diverses prestations ; cela représente environ 88 400 habitants, soit plus de la moitié des habitants de Grenoble. Ces allocations permettent à de nombreux ménages de voir leurs revenus disponibles augmenter par rapport aux revenus déclarés, même si cela est insuffisant pour que les ménages aient tous un revenu qui permette de vivre dignement.
L’INSEE a fait le point sur certaines prestations par quartiers IRIS.
Les prestations sont accordées sous conditions de ressources ; elles sont calculées en tenant compte de la situation familiale, de la nature du logement et du lieu de résidence du bénéficiaire.
Dans le tableau ci-dessous on trouve pour chaque quartier IRIS : le nombre de foyers allocataires, le nombre de personnes qui sont couvertes, le taux de ménage allocataire monoparental ; le taux d’allocataires percevant une aide au logement (Aide Personnalisée au Logement, Allocation de Logement Familiale, Allocation de Logement Sociale) ; le taux d’allocataires percevant l’Aide Personnalisée au Logement (APL) ; le taux d’allocataires percevant l’Allocation Adulte Handicapé ; le taux d’allocataires percevant la prime d’activité et le taux d’allocataires percevant le Revenu de Solidarité Active socle.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : grenoble, ménages, politique de la ville, social
Publié dans Politique |
Publié le 30 janvier 2026
Le premier ministre, certainement fatigué par la préparation du budget 2026, se lance dans des annonces totalement délirantes sur la relance de la construction de logement. Il a annoncé vouloir créer 2 millions de nouveaux logements d’ici à 2030, soit en 5 ans, donc en moyenne 400 000 par an. Mais il faudra aller beaucoup plus vite en fin de période pour atteindre les 2 millions fin 2030, car la mise en route du nouveau plan, même très volontariste, ne pourra pas se faire immédiatement. Même ’il invoque la rapidité de la réalisation des Jeux Olympiques de Paris… ou la reconstruction de Notre Dame, ces mises en projets et chantiers ne sont pas instantanés.
Les statistiques officielles indiquent que de décembre 2024 à novembre 2025, 272 692 logements ont été mis en chantier, soit 22,2 % de moins que la moyenne des cinq années précédentes. Donc déjà vouloir stabiliser rapidement à 300 000 logements neufs par an représenterait un bel effort.
Le gouvernement indique que dans le parc social, il veut atteindre 125 000 logements construits dès 2026.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : état, logement, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 23 janvier 2026
Le 21 janvier 2026 est publiée la quatrième vague de l’Observatoire des territoires, réalisée par l’Institut Verian et la Fondation Jean Jaures en partenariat avec la Fédération hospitalière de France (FHF). Elle montre que les difficultés d’accès aux soins sont largement vécues sur l’ensemble du pays et appellent des réponses concrètes, coordonnées et visibles à l’échelle territoriale.
L’an passé, 80 % des Français ont été touchés par le renoncement aux soins au moins une fois. 70% des personnes interrogées estiment que les communes ont un rôle à jouer en matière de santé. La liste animée par Laurence Ruffin à Grenoble a pris ces questions en toute première priorité, ses propositions sont détaillées dans une plaquette intitulée « Oui à la ville qui garantit le droit à la santé à télécharger ici.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : france, santé, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 23 janvier 2026
La précarité énergétique résidentielle touche un ménage sur huit en Isère et fragilise leur quotidien. Si des aides existent, elles restent souvent méconnues. Face à la hausse des prix et aux nouvelles règles, la question devient cruciale pour l’avenir du logement et les conditions de vie de ses habitants. L’OBS’Y (Le réseau des observatoires de la région grenobloise) dans « Regards croisés » traite de la précarité énergétique dans l’Isère.
La loi Climat et résilience prévoit l’interdiction de louer des logements, sociaux comme privés, aux DPE (diagnostic de performance énergétique) notés F à l’horizon 2028 et G depuis 2025. L’application de cette mesure vise à réduire la précarité et à inciter à la rénovation, mais risque aussi de provoquer de la vacance, d’accentuer les tensions du marché locatif, notamment pour les logements étudiants ou privés à vocation sociale avec, en effet report, une tension accrue sur le parc social. S’y ajoutent la raréfaction des ressources planétaires et la volatilité des prix de l’énergie, autant de facteurs accentuant la vulnérabilité des ménages. 18 à 21 % des logements occupés par des locataires pourraient sortir du parc locatif privé à horizon 2028 (classés F ou G). Cela représente 1 600 logements pour le Pays Voironnais, 10 000 pour la Métropole et 1 300 pour Le Grésivaudan.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Energie, isère, précarité, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 9 janvier 2026
Juste avant Noël, le 23 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble donne raison aux salarié.es de Teisseire à Crolles, qui estimaient que le plan de continuation d’activité de Carlsberg qui ferait produire des sirops au Havre par un sous-traitant (Slaur-Sardet) était illégal, puisque non présenté au CSE (comité social et économique).
C’était une façon de contourner la grève des salarié.es de l’usine crolloise. Pour l’instant, la fabrication des sirops Teisseire par un sous-traitant est interdite par le tribunal judiciaire de Grenoble.
Dans leur ordonnance, les juges font droit aux requêtes déposées par le comité social et économique de Teisseire et par le syndicat CGT de l’entreprise. Les plaignants avaient dénoncé l’absence d’information du CSE avant la décision de mise en œuvre du plan de continuation d’activité prise le 20 novembre.
La société Teisseire est condamnée à verser 3000 euros au CSE et 3000 euros à la CGT. La suspension du plan de la direction – et donc l’arrêt de la fabrication des sirops au Havre – doit être effective avant le 3 janvier, sous peine d’une astreinte de 10 000 euros par jour.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : emploi, justice, luttes, Mobilisations, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 9 janvier 2026
Un communiqué de l’Uncas (Union nationale des centres communaux d’action sociale) du 5 janvier 2026 lance un appel solennel au gouvernement, alors que le dispositif d’hébergement est saturé et structurellement insuffisant, la vague de froid actuelle provoque une crise sociale majeure dans laquelle les maires et leurs CCAS se retrouvent en première ligne.
L’Unccas appelle solennellement le gouvernement et les préfets à agir face à l’activation du plan grand froid dans 36 départements et à une vague de froid exceptionnelle, avec des températures descendues en dessous de –10°C. Alors que l’hiver n’est pas terminé, un homme est déjà mort de froid à Reims le soir de Noël.
En France, au moins 350 000 personnes sont aujourd’hui sans domicile personnel, un chiffre qui a plus que doublé en dix ans, illustrant l’aggravation continue du sans-abrisme et de la précarité résidentielle. Dans le même temps, 61 % des appels au 115 restent chaque jour, sans solution, signe d’un dispositif d’hébergement saturé et structurellement insuffisant.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : collectivités, état, hébergement, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 19 décembre 2025
Les bailleurs sociaux devraient remplacer les derniers chauffages au fioul de leurs logements, à l’horizon 2027, et pour changer une partie des chaudières au gaz, selon l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) qui publie le 9 décembre 2025 un état des lieux des vecteurs énergétiques dans le parc des bailleurs sociaux. Cette étude repose sur les données de l’enquête sur les travaux de rénovation énergétique dans les logements (TRELO), réalisée par le Service des données et études statistiques (SDES).
En 2023, 55 % des logements sociaux étaient chauffés au gaz et 21 % via des réseaux de chaleur. Ces deux systèmes de chauffage sont nettement surreprésentés par rapport à ceux utilisés dans le parc privé. À l’inverse, le secteur social recourt très peu au fioul et affiche un taux plus faible dans le déploiement des pompes à chaleur.
Entre 2018 et 2023, les bailleurs sociaux déclarent avoir effectué des travaux sur les systèmes de chauffage de plus de 100 000 logements en moyenne par an, soit plus de 2 % du parc social.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Energie, logement, social, transitions
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 4 décembre 2025
Créé en 1994 sous l’impulsion de l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux), le Collectif ALERTE est un lieu de réflexion et d’échanges inter-associatifs sur la pauvreté et l’exclusion et les meilleurs moyens de les combattre. Il réunit aujourd’hui 34 fédérations et associations nationales de solidarité, engagées dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
Il a pour vocation de porter auprès des pouvoirs publics et de l’opinion la parole des personnes en situation de précarité et d’exclusion, et d’influer sur les politiques de solidarité à mettre en œuvre.
Le 26 novembre 2025, le collectif lance un signal d’alarme notamment à propos de l’Allocation sociale unifiée. Le collectif ALERTE n’a pas d’opposition de principe sur une réforme de l’organisation des prestations sociales si elle permettait de favoriser l’accès aux droits. Mais le discours qui accompagne aujourd’hui ce projet est un discours d’économies qui nous inquiète quant à sa finalité, laquelle devrait avoir pour seule boussole une amélioration des conditions de vie des personnes concernées et faire l’objet, pour ce faire, d’un investissement financier à la hauteur des enjeux.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : alerte, précarité, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 4 décembre 2025
Dans un courrier adressé au Premier ministre, 18 organisations dont l’Unccas (Union nationale des centres communaux d’action sociale) et l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux) alertent sur les disparités territoriales déjà importantes dans le secteur en lien avec les politiques départementales. Elles appellent à préserver la cinquième branche de la sécurité sociale en tant que garante de la solidarité nationale, rejoignant en cela l’appel qu’avaient lancé onze anciens ministres de la Santé le 18 novembre dernier.
Elles réagissent aux annonces du Premier ministre du 14 novembre au Congrès des Départements de France, confirmée par le courrier adressé aux départements le 24 novembre, visant à confier aux départements la tutelle unifiée du champ médico-social. Les associations estiment qu’une telle décision constituerait une rupture majeure dans l’organisation de la protection sociale, avec des conséquences lourdes pour les personnes les plus vulnérables. Depuis des années, les disparités territoriales dans la prise en charge du handicap, du grand âge et de l’aide à domicile sont massives, documentées et unanimement dénoncées. Les restes à charge, les tarifs d’hébergement, les prestations, les moyens humains ou les taux d’encadrement varient fortement selon les politiques départementales. Loin de réduire ces inégalités, le transfert envisagé les amplifierait.
Les 18 réseaux signataires du courrier au Premier ministre sont : Adédom, ADMR, APF, CNDEPAH, Collectif domicile, Fedesap, Fehap, FESP, FHF, FNAAFP/CSF, Fnadepa, FNMF, GEPSo, Nexem, Synerpa, UNA, Uniopss, UNCCAS.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : conseil départemental, personnes âgées, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 21 novembre 2025
Lors du conseil municipal de Grenoble du 3 novembre 2025, des décisions ayant un impact social important ont été adoptées, en particulier celles concernant la Cité éducative de Grenoble ou le soutien financier aux copropriétés de l’Arlequin dans le cadre du plan de sauvegarde.
Grenoble fait partie du programme national « Cité éducative », qui soutient les territoires mobilisés pour la réussite et l’épanouissement de tous les enfants et jeunes. Ce dispositif, porté par l’État et les collectivités, encourage la coopération entre les acteurs éducatifs, sociaux, culturels et associatifs d’un même quartier.Lors du Conseil municipal de ce 3 novembre 2025, la Cité éducative de Grenoble est renouvelée pour la période 2025-2027 avec un élargissement du périmètre et un soutien financier plus conséquent :
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Education, grenoble, logement, quartiers prioritaires, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 14 novembre 2025
Solidarité avec les salariés.es de Mvélo+ en grève le 13 novembre. Après la grève des salariés de M’TAG en juin et octobre, ce sont maintenant les salariés de Mvélo+ qui se mettent en grève. Comme pour la M’TAG, cela fait des mois que les salarié.es de Mvélo+ alertent la direction de Cykleo et les élus du SMMAG. Ils et elles contestent la fin des tarifs solidaires pour les locations de vélos électriques pour les foyers les plus modestes, dénoncent une dégradation des services proposés, protestent contre les salaires qui stagnent, les conditions de travail qui se dégradent, le dialogue social en berne et des tarifs en hausse pour les usagers…
Analyse des conditions de travail des agents du nettoyage et de leurs impacts sur leur santé. Le secteur d’activité du nettoyage présente une plus forte sinistralité que les autres secteurs, objectivé par des taux plus importants d’accidents de travail, de maladies professionnelles – avec en tête les troubles musculo-squelettiques, et une fréquence plus élevée des licenciements pour inaptitude. Ces constats sont également corroborés par différentes enquêtes nationales ou études auprès de ces travailleurs qui déclarent, plus souvent que dans d’autre secteurs, un mauvais état de santé général. L’ensemble des risques professionnels, incluant les risques psychosociaux, sont susceptibles d’interagir et de se combiner, amplifiant ainsi leurs effets sur la santé physique et mentale des salariés du nettoyage. L’Anses recommande de sensibiliser les employeurs, y compris territoriaux, sur ces problématiques.
Plus d’1,5 million de ménages français privés de chèque énergie ? D’après les informations émanant des documents budgétaires du projet de loi de finances pour 2026 (PLF 2026), nous pouvons craindre un important recul du nombre de bénéficiaires du chèque énergie en 2026 (et ce dès 2025), que nous avons évalué à au moins 30%, soit plus d’1,5 million. De surcroît, le PLF 2026 ne prévoit aucune adaptation du barème du chèque, qui, rappelons-le, n’a pas été modifié depuis 2019 alors que les factures des ménages français ont considérablement augmenté depuis ces sept dernières années. Dans ces conditions, la FNCCR et le CNAFAL invitent le législateur dans le cadre des débats afférents au PLF 2026 à rétablir – a minima – le budget 2024 consacré au chèque énergie.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Déplacements, Energie, Mobilisations, santé, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 7 novembre 2025
L’Unaf (Union Nationale des Associations Familiales) développe depuis les années cinquante des budgets-types visant à chiffrer les besoins nécessaires pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir. Pour en savoir plus, consultez la documentation.
Chaque année, elle présente 8 principaux budgets types suivant la composition du ménage et fait les calculs par mois jusqu’en août 2025 pour la France, l’Ile de France et hors Ile de France.
« Des budgets-types pour un minimum de vie décent.
Afin d’évaluer le montant des dépenses de subsistance pour des familles de référence, l’Unaf calcule chaque mois des budgets-types. Ces budgets ne décrivent pas ce que dépensent effectivement les familles, mais déterminent le niveau des dépenses estimées nécessaires pour qu’une famille, de la composition envisagée, vive sans privation.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : budget, ménages, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 7 novembre 2025
Les communes de plus de 3500 habitants vont recevoir, pour l’année 2025, un soutien financier de l’État pour la mise en place du service public de la petite enfance (SPPE). Un arrêté du 22 Octobre 2025 détaille ces aides pour chaque commune. L’association de maires de France (AMF) trouve que les 85 M€, versés sont sous-dimensionnés. En effet elle estime ce montant (en moyenne inférieur à 30 000 €) ne permettra pas de payer un agent spécialement dédié à la petite enfance que beaucoup de communes vont devoir embaucher pour assurer ce nouveau service public imposé par l’Etat.
Seules les communes de plus de 3500 habitants vont toucher cette aide car ce sont les seules qui doivent exercer les 4 compétences du service SPPE : le recensement des besoins des enfants de moins de trois ans, l’information et l’accompagnement des familles, la planification des modes d’accueil, le soutien à la qualité des modes d’accueil recensés. Aucune commune ne touche moins de 20 328 euros, qui est le montant plancher.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : collectivités, enfance, état, social, solidarité
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 26 septembre 2025
Quand la Métropole achète, elle ne se contente pas de passer commande. Elle choisit la société qu’elle veut construire. C’est toute l’ambition du Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER) adopté par la Métropole en 2022. Derrière chaque marché public, il y a la possibilité de soutenir l’économie locale, de créer de l’emploi inclusif et d’accélérer la transition écologique. Elizabeth Debeunne, Vice-présidente chargée de l’économie sociale, solidaire et circulaire (ESS) se réjouit de l’augmentation de la part dédiée à l’ESS dans la commande publique de la Métropole de Grenoble ces dernières années.
Des chiffres qui traduisent une ambition
En 2024, 9,2 millions d’euros ont été investis via cette commande publique « à impact », dont 6,2 millions dédiés à l’économie sociale et solidaire et 3,03 millions orientés vers des structures d’insertion et du secteur du handicap. En deux ans, les montants engagés ont progressé de manière significative : +18 % entre 2023 et 2024. Une dynamique qui prouve que l’achat public peut être pensé comme un levier pour transformer le territoire, tant sur le plan écologique que social, via l’activité économique. Dans la Métropole de Grenoble, chaque marché doit être une décision qui compte : acheter autrement, c’est déjà transformer la ville et la vie de ses habitantes et habitants.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : économie, métropole, social, solidarité
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 26 septembre 2025
La Quadrature du net après avoir dénoncé les dérives de l’algorithme de notation utilisé par la CAF pour sélectionner les personnes à contrôler, aborde la question des contrôles CAF réalisés sur signalements policiers. Utilisée par la police comme arme de répression sociale et politique, cette pratique symbolise l’instrumentalisation par l’État des administrations sociales à des fins de contrôle.
« Au problème politique que soulève l’utilisation d’une institution sociale à des fins de répression policière s’ajoute le fait que cette pratique souffre d’une absence d’encadrement. Ces « signalements » sont réalisés en dehors de tout cadre judiciaire et n’ont, dans les faits, pas à être motivés par la police. Ceci génère un risque de recours aux « signalements » à des fins de harcèlement policier.
Qui plus est, cette procédure est particulièrement opaque. La personne contrôlée n’a ainsi pas connaissance du fait que ses déclarations devant la police, lors d’une garde-à-vue par exemple, peuvent être transmises à la CAF, alors que cette possibilité entre en contradiction avec le principe du secret de l’instruction. Également, en cas de « signalement », la personne visée ignore que son contrôle résulte d’une demande de la police et n’a pas accès aux informations communiquées à la CAF.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : police, répression, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 12 septembre 2025
A propos du projet de loi de la sécurité sociale, lors d’une conférence de presse le 2 septembre 2025, la Fédération Hospitalière de France(FHF) a notamment appelé à une progression de l’ONDAM (objectif national de dépenses d’assurance maladie) de 3 % en 2026, ce afin de répondre aux besoins des établissements publics et de soutenir la reprise d’activité de ces derniers mois. Une telle évolution est nécessaire, sans quoi la dynamique engagée s’essoufflera rapidement. Dans le champ médico-social, une progression de 4 % est impérieuse pour poursuivre le développement de l’offre et répondre aux nécessités démographiques.
Pour associer soutenabilité financière et visibilité pour les établissements, cette progression doit s’inscrire dans une perspective pluriannuelle, seule capable de donner au système de santé la stabilité dont il a tant besoin.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : budget, santé, Sécurité, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 18 juillet 2025
L’adaptation des logements sociaux aux fortes chaleurs est un défi majeur et peut-être plus complexe à relever que la l’adaptation contre le froid. Un rapport du 9 juillet 2025 de l’Agence nationale de contrôle du logement social, l’ANCOLS, réalise un état des lieux qualitatif des stratégies mises en place par les bailleurs sociaux concernant l’inconfort dans les logements lors de fortes chaleurs. Cette étude est issue des échanges réalisés auprès de trente bailleurs sociaux, implantés sur l’ensemble du territoire national y compris ultramarin et de dix organismes institutionnels accompagnant les bailleurs sur les sujets environnementaux.
Le besoin d’adaptation des logements aux fortes chaleurs est un sujet identifié par les bailleurs. En effet d’ici 2050, les projections indiquent que près de 25 millions de logements sur le territoire français seront exposés à au moins 20 jours de vague de chaleur par an.
Néanmoins cette adaptation est globalement, faiblement intégrée dans leurs stratégies, avec des situations hétérogènes. Les bailleurs les plus moteurs sont ceux situés dans le Sud, les groupes nationaux et ceux confrontés aux îlots de chaleur urbains.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : climat, logement, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |