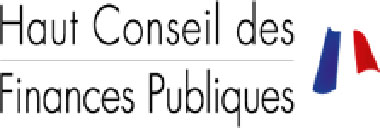Archives pour le mot-clef ‘Europe’
Publié le 21 mars 2025
Les restaurants intergénérationnels de la Ville et du CCAS sont ouverts à toutes et tous. Les restaurants des Pôles d’Animation Gérontologique et Intergénérationnelle (PAGI) de la Ville et du CCAS sont ouverts à toutes et tous. Il suffit de s’inscrire dans le restaurant de son choix. Le prix du repas est calculé en fonction des revenus. Chaque lieu propose également des animations : temps festifs, ateliers, conférences, jeux… En cette période, où de plus en plus de personnes sont en difficultés pour se nourrir mais et où le lien social se fragilise, bravo à cette initiative qui permet à toutes et tous d’accéder à des repas équilibrés, de bonne qualité dans un espace convivial, de lutter contre l’isolement et de permettre aux résident.e.s des Ephad, d’être plus intégré.e.s à une vie de quartier.
Les habitant-es se saisissent de nouvelles méthodes pour enrichir le patrimoine arboré de la ville. À Grenoble, un nouveau projet de micro-forêt urbaine voit le jour grâce au Budget participatif 2023. La méthode Miyawaki, qui permet une plantation à développement rapide et dense, est utilisée pour créer un espace vert en plein cœur du quartier Beauvert. Cette initiative vise à renforcer la végétalisation de la ville, lutter contre les îlots de chaleur et améliorer la qualité de vie des habitant-es. Contrairement à une plantation classique qui prend plusieurs décennies, cette méthode densifie les espaces en plantant jusqu’à trois arbres par mètre carré, ce qui permet aux jeunes pousses de se développer rapidement. En utilisant des essences locales et diversifiées, le projet contribue également à la biodiversité et à la résilience des écosystèmes urbains.
Projet Omnibus européen : nouveau terrain de jeu pour les lobbies. Le projet “Omnibus” est une vaste entreprise de déréglementation qui vide les obligations de leur substance, en matière de devoir de vigilance et de transparence sur l’impact environnementale et climatique. Conçu par la Commission Européenne dans le cadre d’un processus opaque qui ignore les règles de gouvernance et de démocratie de l’Union, il met en péril des années de travail législatif visant à exiger des entreprises le respect les droits humains et sociaux, la préservation de l’environnement et un alignement sur les objectifs climatiques. Reclaim Finance a analysé la proposition Omnibus dans une note et met en évidence une très forte similarité entre son contenu et les souhaits des lobbies industriels. Ces éléments suggèrent que le projet Omnibus a été capturé par les lobbies et fait de son arrêt une nécessité démocratique.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Europe, Nature, personnes âgées
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 14 mars 2025
La situation géopolitique a profondément changé avec l’arrivée de Trump au pouvoir évènement qui se conjugue avec la politique de la Russie de Poutine ; il y a un danger réel pour la stabilité de l’Europe depuis l’invasion de l’Ukraine, le droit international est violé de par l’intervention russe dans les campagnes électorales de différents états européens pour aider les candidats d’extrême droite.
Qu’une majorité d’Etats européens, veuillent renforcer leurs budgets militaires parait une attitude politique compréhensible. Par contre le discours de Macron qui explique vouloir augmenter fortement les dépenses militaires, sans augmenter les impôts est inacceptable : sur quelles dépenses seront faites les économies pour dégager les recettes nécessaires à cette option ? Nous pensons que ce sera sur les dépenses d’intérêt social et écologique, déjà largement menacées (école, santé, sécurité sociale, retraites, collectivités locales…). Le recours à la dette sera nécessairement très limité vu les taux d’intérêts des emprunts devenus plus élevés pour notre pays.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : défense, état, Europe, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 28 février 2025
Le 27 février 2025, la Cour Européenne des Droits de l’Homme et des Liberté (CEDH) a condamné, à l’unanimité, la France pour sa responsabilité dans la mort de Rémi Fraisse lors d’affrontements contre le projet de barrage de Sivens (Tarn).
Les juges invoquent une violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, concernant le « droit à la vie ».
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire… »
Rémi Fraisse âgé de 21 ans, avait été tué par l’explosion d’une grenade offensive lancée par un gendarme, dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : droits, Europe, justice, Mobilisations
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 6 décembre 2024
Le 16 septembre 2024, le Parlement européen a adopté le projet de révision d’une nouvelle directive, suivi ensuite par le Conseil de l’Europe le 14 octobre 2024, ce qui a permis la publication de cette directive le 20 novembre 2024. Directive qui concerne la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.
Cette directive va imposer de nouvelles normes sur la qualité de l’air à partir de 2030, mais qui n’atteindront pas encore les normes de l’OMS.
Comme l’ont déjà démontré de nombreuses études scientifiques, l’exposition à la pollution atmosphérique engendre une multitude de problèmes de santé, notamment des maladies respiratoires, cardiovasculaires et même l’augmentation de risques de certains cancers.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Europe, pollution atmosphérique, santé
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 14 juin 2024
Globalement, le parlement européen glisse encore à droite, le poids des listes d’extrême-droite y est plus important que précédemment. Les politiques publiques financées par la Commission européenne vont en subir d’importantes conséquences. Les tractations ont débuté pour décider qui présidera la Commission, il n’est pas certain que la présidente sortante soit désignée.
En France, on note une légère amélioration de la participation de 1,5 points, jusqu’à 51,5%, mais une poussée de l’extrême droite, un effondrement de la macronie et un affaiblissement conséquent du vote pour la liste des écologistes.
L’extrême droite atteint maintenant 40 % des suffrages, dominée par le RN (31,4%), puis Marion Maréchal dépasse les 5% et donc a des élu-es et 3% pour d’autres listes. La droite LR se tasse encore diminuant de 8,5% à 7,3%.
L’effondrement de la macronie qui chute de 8 points de 22,4% à 14,6%.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : élections, Europe, france
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 24 mai 2024
Il y aura 37 listes à l’élection des représentants au Parlement européen du 9 juin prochain. Chacune de ces listes comporte 81 noms, avec une alternance de candidats de chaque sexe. Il y en avait 34 en 2019. La grande majorité de ces listes ne sont pas pour faire un score, mais se faire connaitre. En 2019 il y avait 34 listes, dont seules les 6 premières ont dépassé les 5% des exprimés et ont eu des élu-es.
L’ordre de présentation de ces listes a été arrêté par tirage. Il détermine l’ordre d’affichage sur les panneaux électoraux à compter du 27 mai (début de la campagne électorale) et de présentation des bulletins sur la table de décharge dans les bureaux de vote le jour du scrutin.
L’arrêté qui fixe les listes des candidats à l’élection des représentants au Parlement européen, est consultable ici.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : élections, Europe
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 10 mai 2024
Recherche assesseurs pour l’élection européenne du 9 juin 2024 : Les assesseurs jouent un rôle essentiel pour le bon déroulement de la tenue des 82 bureaux de vote à Grenoble. Une heure d’information-formation des assesseur-es se tiendra en mairie préalablement au déroulement du scrutin. Inscription sur le site de la ville, à l’accueil en mairie ou par téléphone au : 04 76 76 36 36.
Mots-clefs : élections, Europe, grenoble
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 3 mai 2024
Table ronde sur les élections européennes lundi 6 mai à 18h à la Maison des associations de Grenoble. Organisée par le Pacte du Pouvoir de Vivre de l’Isère avec les représentants des partis LR, Renaissance, les écologistes, PS, LFI, PCF. Le manifeste — Pacte du pouvoir de vivre
Mercredi 8 mai 2024 à 15h, dans le parc Parc André Malraux, près de la mairie de Fontaine, Mail Marcel Cachin (tram A, arrêt Hôtel de Ville La Source) rassemblement à la mémoire des milliers de victimes du colonialisme qui manifestaient le 8 mai 1945 en Algérie à Sétif, Guelma et Kherrata. Voir article.
Mots-clefs : agenda, Europe
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 12 avril 2024
Le 9 avril 2024, la cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rejeté les recours de jeunes Portugais dénonçant l’inaction de leur pays et de 31 autres, face au changement climatique, ainsi que le recours de Damien Carême. Par contre et c’est une première, elle condamne la Suisse pour violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que pour violation de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal). Cette condamnation va faire jurisprudence.
Voici des extraits du communiqué de la CEDH concernant la condamnation de la Suisse :
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : climat, Europe, justice
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 14 mars 2024
Le mercredi 28 février pour la première fois, le Parlement européen vote en faveur d’un cessez-le-feu inconditionnel et permanent à Gaza.
Précédemment, le 18 janvier, l’institution s’était déjà prononcée en faveur d’un cessez-le-feu permanent, en le conditionnant toutefois à la libération des otages israéliens et au démantèlement du Hamas, listé par l’UE comme organisation terroriste.
Depuis l’attaque sanglante du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, qui a fait 1.160 morts, la riposte israélienne a transformé Gaza en « zone de mort« , selon l’ONU, et fait 30.000 morts côté palestinien, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, sur les 2,4 millions d’habitants que compte la bande de Gaza 1,7 millions de Palestiniens ont été chassés de leur foyer. Les Etats Unis et le Qatar, principaux médiateurs dans la guerre, disent espérer obtenir une trêve permettant la libération d’otages détenus à Gaza avant le début du ramadan, démarré les 10 ou 11 mars.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Europe, Palestine, parlement
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 8 mars 2024
Contrairement aux discours répétés de la droite et du gouvernement (de droite), mais sans aucune analyse précise, les ménages français composants la classe moyenne ne sont pas et de loin les plus imposés en Europe. C’est le résultat d’une étude du média Euronews.
Une première étude sur le salaire minimum montrait que la France se situait dans le haut du tableau en 6ème position derrière le Luxembourg, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Belgique et nettement devant le 7ème qui est l‘Espagne.
Sur le poids de la fiscalité sur la classe moyenne, la France est beaucoup plus loin dans le classement européen, elle se situe autour du 13 ème rang cela dépend de la composition du ménage et du revenu moyen
« Selon la définition de l’OCDE, la classe moyenne désigne les ménages dont le revenu se situe entre 75 % et 200 % du revenu national médian. Elle est divisée en trois sous-catégories :
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Europe, Impôts
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 31 mars 2023
L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) a participé à une recherche sur le thème d’une agriculture européenne sans pesticides chimiques à l’horizon 2050. Durant plus de 2 ans, avec plus d’une centaine d’experts, la prospective « Agriculture européenne sans pesticides chimiques à l’horizon 2050 » a exploré les chemins possibles pour concevoir une agriculture sans pesticides à l’échelle européenne.
Le 21 mars lors d’un colloque de restitution rassemblant près de 1 400 participants de 64 nationalités à Paris, avec témoignages de divers acteurs français et européens des mondes agricole, réglementaire et politique, de l’agriculture, de l’environnement et de l’alimentation, trois scénarii d’agriculture sans pesticide, les évolutions nécessaires du système agricole et alimentaire ont été présentées. Chaque scénario s’accompagne de trajectoires pour la transition européenne et régionale de l’ensemble du système alimentaire. Les scénarii répondent à la question : dans quelles conditions une agriculture sans pesticide serait-elle possible ? Quels seraient ses impacts sur la production, l’usage des terres, la balance commerciale et les émissions de gaz à effet de serre (GES) ? Les trois scénariossupposent un véritable bouleversement des pratiques agricoles et affectent fortement l’ensemble de la filière, en commençant par les consommateurs.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : agriculture, Europe, pesticides
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 28 janvier 2023
Le 19 janvier 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a donné un sévère coup d’arrêt à l’utilisation des néonicotinoïdes en rappelant aux Etats membres qu’ils ne peuvent pas déroger aux interdictions expresses de mise sur le marché ni utiliser des semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques en contenant.
Le gouvernement français a hésité et cherché à échapper à cette interdiction, mais le 23 janvier, le ministre de l’agriculture a renoncé à demander une mesure dérogatoire autorisant l’usage des insecticides néonicotinoïdes, utilisés pour les semences de betteraves sucrière.
Deux associations de lutte contre les pesticides et de promotion de la biodiversité ainsi qu’un apiculteur, ont formé devant le Conseil d’État belge un recours contre ces autorisations, qui seraient accordées de manière abusive, plusieurs années d’affilée et sans justifications suffisantes. Ces requérants font valoir que ces néonicotinoïdes sont utilisés de manière croissante à travers la technique de l’enrobage des semences, en ce sens que, au lieu d’être pulvérisés sur la culture, ils sont préventivement appliqués sur les semences avant l’ensemencement, sans égard à la présence avérée ou non des insectes que ces produits visent à éliminer.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : biodiversité, droit, Europe, france, justice
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 3 juin 2022
Le pesticide le plus utilisé dans le monde, le glyphosate, a une autorisation de mise sur le marché européen qui se termine fin 2022 et devrait recevoir prochainement une nouvelle autorisation par l’Union européenne. En effet l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a rendu publique, lundi 30 mai, la conclusion de son évaluation de l’herbicide.
« Le Comité d’évaluation des risques (RAC) de l’ECHA accepte de conserver la classification actuelle du glyphosate comme causant de graves lésions oculaires et étant toxique pour la vie aquatique. Sur la base d’un vaste examen des preuves scientifiques, le comité conclut à nouveau que la classification du glyphosate comme cancérogène n’est pas justifiée. »
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Europe, pesticides
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 3 juin 2022
Le Conseil Constitutionnel va se prononcer sur les 1607 h de temps de travail dans les collectivités. Le Conseil d’Etat a en effet transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’application des règles sur le temps de travail dans les collectivités, fixé obligatoirement à 1.607 heures annuelles. Les communes qui ont déposé cette QPC s’appuient sur l’atteinte disproportionnée à la libre administration des collectivités territoriales et à la liberté que ne justifierait aucun motif d’intérêt général.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie son rapport d’activité 2021. Il permet à la Haute Autorité d’établir un bilan de ses missions lors de la mandature écoulée et de se projeter dans celle à venir, au regard des échéances électorales majeures de 2022. La Haute Autorité formule dix propositions, afin de garantir des contrôles plus efficaces et d’approfondir la prévention des atteintes à la probité.
Nucléaire, non merci. Un long interview par Reporterre d’un grand spécialiste du nucléaire civil, Bernard Laponche qui professionnellement a été physicien au CEA et a été un militant syndicaliste qui a œuvré pour ouvrir les yeux sur les dangers de cette industrie. Il n’y va pas par quatre chemins : « Le nucléaire est dangereux, et ceux qui s’en occupent tout autant ! » et « Les industriels sont dans le déni, les politiques n’y connaissent rien »
Europe : dépenses climatiques du budget 2014-2020 surestimées. L’Union Européenne s’est engagée à consacrer au moins 20 % de son budget 2014-2020 à l’action pour le climat. La Commission a annoncé que cet objectif avait été atteint, avec 216 milliards d’euros de dépenses climatiques déclarées pour cette période. La Cour des comptes européenne constate que celles-ci n’étaient pas toujours liées à des actions en faveur du climat et qu’elles étaient globalement surestimées, de 72 milliards d’euros au moins.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : climat, collectivités, emploi, Europe, nucléaire, transparence
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 14 janvier 2022
Puisque la France assure la présidence tournante de l’Union européenne au cours du premier semestre de 2022, elle devrait prendre en compte la recommandation suivante : la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (cnDAspe), chargée par la loi de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique, recommande au gouvernement de proposer une nouvelle expertise du pré-rapport rédigés en juin 2021 par des experts des agences règlementaires de quatre Etats (France, Hongrie, Pays-Bas et Suède) qui estimait que le glyphosate ne remplissait aucun critère d’interdiction, contrairement aux exopertises du cIRC (Centre international de recherche sur e cancer) et de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale).
Le cnDAspe recommande au gouvernement :
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Europe, santé
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 29 octobre 2021
En octobre 2021, 136 pays et juridictions ont convenu de la mise en œuvre rapide d’une réforme majeure du système international d’imposition des sociétés. Dans une note, l’Observatoire européen de la fiscalité présente des simulations des effets de l’introduction de l’impôt minimum mondial de 15% prévu par cet accord sur les recettes fiscales. L’analyse est basée sur les statistiques pays par pays les plus récentes publiées par l’OCDE. L’Union européenne recevrait plus de 80 milliards d’euros de recettes supplémentaires, la France presque 4 milliards. Ce sont les pays développés qui y gagneraient le plus, 19% d’augmentation de recettes fiscales contre 2% pour les pays en développement.
En voici les principales conclusions :
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Europe, fiscalité
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |