 En raison des vacances, « Le Rouge et le Vert » ne paraîtra pas vendredi 20 avril.
En raison des vacances, « Le Rouge et le Vert » ne paraîtra pas vendredi 20 avril.
Samedi 14 avril 14 h 30 – Place Félix Poulat à Grenoble, rassemblement contre le projet de loi liberticide et gravement attentatoire aux droits fondamentaux des migrant-e-s. Suivi d’une marche jusqu’à la Préfecture. A l’appel de la CISEM (Coordination iséroise de solidarité avec les étrangers migrants).
Samedi 21 avril à 10 h 30, rassemblement devant le bureau de poste de Championnet (1 Rue de Turenne à Grenoble) pour protester contre la fermeture des bureaux de poste de Grand Place et Championnet.
Jusqu’au 27 avril 2018, dans le hall d’honneur de l’Hôtel de Ville : prolongation de l’exposition « Hier Malville, aujourd’hui la France », autour de l’œuvre de Jean-Marc Rochette : regards sur le danger nucléaire.

 Après le Conseil d’administration de la CCIAG autorisant le directeur à signer le nouveau contrat de DSP, c’est le Conseil de métropole qui a autorisé le 6 avril, le président de la Métro à signer ce contrat qui va être effectif au 1er juillet 2018 pour 15 ans.
Après le Conseil d’administration de la CCIAG autorisant le directeur à signer le nouveau contrat de DSP, c’est le Conseil de métropole qui a autorisé le 6 avril, le président de la Métro à signer ce contrat qui va être effectif au 1er juillet 2018 pour 15 ans. Lors de la réunion du conseil de la Métro du 6 avril, des élus communistes et des élus des petites communes se sont élevés contre une subvention à une association qui contribue à la vie démocratique de l’agglomération : LAHGGLO qui fédère les associations de quartier de l’ensemble des communes de l’agglomération. Ces élus protestaient contre le fait d’avoir reçu sur leurs adresses électroniques des courriers qui exposaient les arguments de l’association qui l’a amené à donner un avis négatif à l’enquête publique sur le projet Neyrpic à Saint Martin d’Hères. LAHGGLO a demandé qu’il y ait « une nouvelle saisine de la CDAC ; un avis des communes et territoires voisins ; un avis politique de la métropole. » Donc rien de répréhensible.
Lors de la réunion du conseil de la Métro du 6 avril, des élus communistes et des élus des petites communes se sont élevés contre une subvention à une association qui contribue à la vie démocratique de l’agglomération : LAHGGLO qui fédère les associations de quartier de l’ensemble des communes de l’agglomération. Ces élus protestaient contre le fait d’avoir reçu sur leurs adresses électroniques des courriers qui exposaient les arguments de l’association qui l’a amené à donner un avis négatif à l’enquête publique sur le projet Neyrpic à Saint Martin d’Hères. LAHGGLO a demandé qu’il y ait « une nouvelle saisine de la CDAC ; un avis des communes et territoires voisins ; un avis politique de la métropole. » Donc rien de répréhensible. Suite à l’enquête publique et aux conclusions du commissaire enquêteur, un certain nombre de réserves devaient être levées pour que l’avis favorable ne se transforme pas en un avis défavorable et fragilise le dossier de permis de construire que le maire de Saint Martin d’Hères (SMH) a l’intention de délivrer rapidement.
Suite à l’enquête publique et aux conclusions du commissaire enquêteur, un certain nombre de réserves devaient être levées pour que l’avis favorable ne se transforme pas en un avis défavorable et fragilise le dossier de permis de construire que le maire de Saint Martin d’Hères (SMH) a l’intention de délivrer rapidement.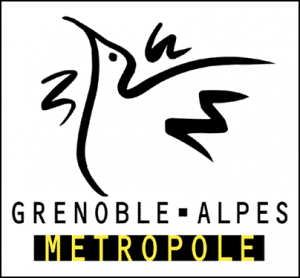 Au 1er Janvier 2017, en application des dispositions de la loi Notre le département avait transféré à la Métropole la prévention spécialisée (en même temps que le bitume des routes départementales). Cela a permis de sauver, en les pérennisant, les financements de cette compétence. On se souvient que le nouvel exécutif du Département avait engagé en 2016, de large coupe budgétaire (- 11%) en la matière ce qui, à brève échéance, aurait fait disparaitre cette politique publique pourtant essentielle pour nos jeunes métropolitains ! Après une année de travail, de concertations et de diagnostic avec les acteurs de terrains, les 3 structures associatives (l’AP, l’APASE et le Codase) des habitants et avec la participation des communes concernées, la métropole a adopté en septembre 2017 sa stratégie territoriale de prévention spécialisée 2017-2020. Elle a précisé le 6 avril dernier, les territoires sur lesquels les éducateurs de la prévention spécialisés pourront accompagner les jeunes métropolitains. Les modifications majeures concernent l’âge des jeunes pouvant bénéficier de ce dispositif : il est aujourd’hui de 11 à 21 ans (avant le département l’avait limité aux 12 – 18 ans) avec une attention particulière envers les jeunes en rupture scolaire et sociale. Il s’agira d’accompagner aussi des jeunes qui, s’ils n’habitent pas expressément dans un des Quartiers Politique de la Ville (QPV), agissent dans ces bassins de vie.
Au 1er Janvier 2017, en application des dispositions de la loi Notre le département avait transféré à la Métropole la prévention spécialisée (en même temps que le bitume des routes départementales). Cela a permis de sauver, en les pérennisant, les financements de cette compétence. On se souvient que le nouvel exécutif du Département avait engagé en 2016, de large coupe budgétaire (- 11%) en la matière ce qui, à brève échéance, aurait fait disparaitre cette politique publique pourtant essentielle pour nos jeunes métropolitains ! Après une année de travail, de concertations et de diagnostic avec les acteurs de terrains, les 3 structures associatives (l’AP, l’APASE et le Codase) des habitants et avec la participation des communes concernées, la métropole a adopté en septembre 2017 sa stratégie territoriale de prévention spécialisée 2017-2020. Elle a précisé le 6 avril dernier, les territoires sur lesquels les éducateurs de la prévention spécialisés pourront accompagner les jeunes métropolitains. Les modifications majeures concernent l’âge des jeunes pouvant bénéficier de ce dispositif : il est aujourd’hui de 11 à 21 ans (avant le département l’avait limité aux 12 – 18 ans) avec une attention particulière envers les jeunes en rupture scolaire et sociale. Il s’agira d’accompagner aussi des jeunes qui, s’ils n’habitent pas expressément dans un des Quartiers Politique de la Ville (QPV), agissent dans ces bassins de vie. France urbaine (association des élus des métropoles, agglomérations et grandes villes) a organisé des journées nationales les 5 et 6 avril à Dijon, notamment sur la contractualisation avec l’Etat des trajectoires financières des collectivités durant les trois prochaines années. De nombreuses critiques ont été soulevées à ce propos : ce type de contrat est en fait un contrôle de l’Etat sur les collectivités, c’est un accusé de réception plutôt qu’un vrai contrat, c’est un retour à la tutelle préfectorale qui existait avant la décentralisation, les préfets ont peu de marges de manœuvre. La question de la définition précise des dépenses sur lesquelles les collectivités doivent s’engager n’est pas claire, de nombreux élus demandant à ce que certaines dépenses imposées par l’Etat soient sorties des contrats par exemple : coûts supplémentaires liés aux QPV, élargissement des horaires d’ouverture des bibliothèques, transfert de l’enregistrement des Pacs, nouvelle compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi)…
France urbaine (association des élus des métropoles, agglomérations et grandes villes) a organisé des journées nationales les 5 et 6 avril à Dijon, notamment sur la contractualisation avec l’Etat des trajectoires financières des collectivités durant les trois prochaines années. De nombreuses critiques ont été soulevées à ce propos : ce type de contrat est en fait un contrôle de l’Etat sur les collectivités, c’est un accusé de réception plutôt qu’un vrai contrat, c’est un retour à la tutelle préfectorale qui existait avant la décentralisation, les préfets ont peu de marges de manœuvre. La question de la définition précise des dépenses sur lesquelles les collectivités doivent s’engager n’est pas claire, de nombreux élus demandant à ce que certaines dépenses imposées par l’Etat soient sorties des contrats par exemple : coûts supplémentaires liés aux QPV, élargissement des horaires d’ouverture des bibliothèques, transfert de l’enregistrement des Pacs, nouvelle compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi)… Le service public de l’eau est un service industriel et commercial ce qui lui interdit de faire de la tarification sociale car l’eau doit payer l’eau et pas la solidarité. Mais en 2013 la loi dite Brottes a instauré en son article 28 une possibilité d’expérimentation d’une tarification sociale durant une période de 5 ans. L’expérimentation devait donc se terminer le 15 avril 2018. Mais cette expérimentation a mis longtemps à se mettre en place et de nombreuses collectivités l’ont démarré tard et les rapports d’évaluation prévus par l’article 28 de la loi Brottes n’ont pas été remis, ce qui interdit de se prononcer maintenant sur une éventuelle généralisation.
Le service public de l’eau est un service industriel et commercial ce qui lui interdit de faire de la tarification sociale car l’eau doit payer l’eau et pas la solidarité. Mais en 2013 la loi dite Brottes a instauré en son article 28 une possibilité d’expérimentation d’une tarification sociale durant une période de 5 ans. L’expérimentation devait donc se terminer le 15 avril 2018. Mais cette expérimentation a mis longtemps à se mettre en place et de nombreuses collectivités l’ont démarré tard et les rapports d’évaluation prévus par l’article 28 de la loi Brottes n’ont pas été remis, ce qui interdit de se prononcer maintenant sur une éventuelle généralisation. Le 28 mars 2018, le groupe Caisse d’Epargne rend une étude intitulée : « DYNAMIQUES NATIONALE ET TERRITORIALES DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL : État des lieux et enjeux à moyen terme ».
Le 28 mars 2018, le groupe Caisse d’Epargne rend une étude intitulée : « DYNAMIQUES NATIONALE ET TERRITORIALES DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL : État des lieux et enjeux à moyen terme ». Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) a publié début 2018
Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) a publié début 2018  L’Ofpra ( Office français de protection des réfugiés et apatrides) est l’établissement public chargé de l’application des règles relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, d’apatride et à l’admission à la protection subsidiaire ; cette dernière est accordée à toute personne dont la situation ne répond pas à la définition du statut de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : la peine de mort ou une exécution ; la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; pour des civils, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.
L’Ofpra ( Office français de protection des réfugiés et apatrides) est l’établissement public chargé de l’application des règles relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, d’apatride et à l’admission à la protection subsidiaire ; cette dernière est accordée à toute personne dont la situation ne répond pas à la définition du statut de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : la peine de mort ou une exécution ; la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; pour des civils, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. Alors que le gouvernement avait promis que la dotation globale de fonctionnement (DGF) ne diminuerait pas, en fait 2/3 des communes voient leur dotation diminuée. Le 4 avril les dotations 2018 sont mises en ligne sur le site de la DGCL (direction générale des collectivités locales).
Alors que le gouvernement avait promis que la dotation globale de fonctionnement (DGF) ne diminuerait pas, en fait 2/3 des communes voient leur dotation diminuée. Le 4 avril les dotations 2018 sont mises en ligne sur le site de la DGCL (direction générale des collectivités locales). La Cour des comptes européenne (CCE) a publié le 20 mars un rapport mettant en garde les Etas membres contre le recours aux partenariats public-privé (PPP). Douze PPP cofinancés par l’Union européenne (UE) ont été audités et le bilan s’avère plutôt sévère. Intitulé « Les partenariats public-privé dans l’UE : de multiples insuffisances et des avantages limités », ce rapport dresse un sombre tableau de l’utilisation de ces contrats. Entre 2000 et 2014, l’UE a cofinancé 84 PPP à hauteur de 5,6 milliards, pour un montant total de 29,2 milliards d’euros. Afin d’évaluer l’efficacité de ces PPP, la CCE en a audité douze. Le bilan financier de ces douze PPP est lourd puisque 1,5 milliard d’euros ont été dépensés de manière inefficiente et inefficace ! La position de la CCE est claire : les PPP « ne peuvent être considérés comme une option économiquement viable pour la fourniture d’infrastructures publiques ». La CCE indique que « pour la plupart des projets examinés, le choix du PPP n’avait été précédé d’aucune analyse comparative des autres options ». Les acheteurs n’avaient donc aucune preuve que le recours au PPP serait la meilleure option pour optimiser les ressources
La Cour des comptes européenne (CCE) a publié le 20 mars un rapport mettant en garde les Etas membres contre le recours aux partenariats public-privé (PPP). Douze PPP cofinancés par l’Union européenne (UE) ont été audités et le bilan s’avère plutôt sévère. Intitulé « Les partenariats public-privé dans l’UE : de multiples insuffisances et des avantages limités », ce rapport dresse un sombre tableau de l’utilisation de ces contrats. Entre 2000 et 2014, l’UE a cofinancé 84 PPP à hauteur de 5,6 milliards, pour un montant total de 29,2 milliards d’euros. Afin d’évaluer l’efficacité de ces PPP, la CCE en a audité douze. Le bilan financier de ces douze PPP est lourd puisque 1,5 milliard d’euros ont été dépensés de manière inefficiente et inefficace ! La position de la CCE est claire : les PPP « ne peuvent être considérés comme une option économiquement viable pour la fourniture d’infrastructures publiques ». La CCE indique que « pour la plupart des projets examinés, le choix du PPP n’avait été précédé d’aucune analyse comparative des autres options ». Les acheteurs n’avaient donc aucune preuve que le recours au PPP serait la meilleure option pour optimiser les ressources La Cour des comptes publie le 10 avril un référé très sévère sur les politiques fiscales successives concernant l’accession à la propriété pour investir : lois Périssol, Besson, Robien, Borloo, Scellier, Duflot et Pinel. Elle conclut à un coût élevé face à leur faible efficacité mesurable. Elle recommande au gouvernement une sortie progressive et sécurisée de ces dispositifs récemment reconduits, et de renforcer la place des investisseurs institutionnels dans la construction et la location de logements privés. Le gouvernement a deux mois pour répondre.
La Cour des comptes publie le 10 avril un référé très sévère sur les politiques fiscales successives concernant l’accession à la propriété pour investir : lois Périssol, Besson, Robien, Borloo, Scellier, Duflot et Pinel. Elle conclut à un coût élevé face à leur faible efficacité mesurable. Elle recommande au gouvernement une sortie progressive et sécurisée de ces dispositifs récemment reconduits, et de renforcer la place des investisseurs institutionnels dans la construction et la location de logements privés. Le gouvernement a deux mois pour répondre.