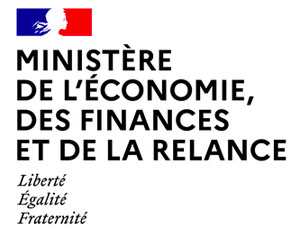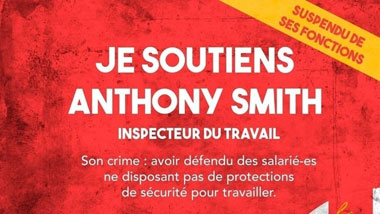Archives pour le mot-clef ‘droit’
Publié le 15 avril 2022
La direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’économie édite régulièrement une lettre notant les actualités juridiques sur de très nombreux thèmes. Dans sa dernière lettre n° 337 du 7 avril 2022, elle fait le point sur l’état législatif de la protection des lanceurs d’alerte depuis la loi Sapin 2 de 2016 jusqu’aux lois organique et ordinaire du 21 mars 2022. Il est rappelé le rôle du Défenseur des droits à ce sujet et que ce dernier devra faire un rapport public sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte au Président de la République et aux présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : alerte, droit, économie
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 21 mai 2021
Le 7 mai 2021, le maire de
Grenoble a envoyé une lettre ouverte aux directions des deux sociétés qui dominent
les livraisons des repas à domicile à Grenoble, Uber Eats et Deliveroo,
critiquant les conditions de travail des livreurs qui ne sont pas salariés et
qui sont soumis à des pressions très fortes, des rémunérations indignes et des
insécurités multiples.
Voici des extraits de cette
lettre :
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : commerce, droit, modes actifs, précarité, travail
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 6 novembre 2020
Le 20 octobre 2020, des
députés LREM et d’Agir ensemble ont déposé une proposition de loi relative à
« la sécurité globale ». Parmi les nombreux signataires on
trouve Mme Chalas. Elle sera débattue en urgence dès le 4 novembre. Certains
articles sont très dangereux pour les libertés individuelles et pour le droit
de manifester. L’article 21 veut déréguler l’utilisation des caméras mobiles
portées par les forces de l’ordre, l’article 22 veut légaliser la surveillance
par drone et l’article 24 vise à interdire au public de diffuser l’image de
policiers.
Cette utilisation de la
situation actuelle marquée par l’état d’urgence sanitaire et les attentats
terroristes est très inquiétante vu la mise en cause de notre état de droit
respectueux des libertés fondamentales.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : droit, libertés, parlement
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 30 octobre 2020
Les lecteurs des deux
derniers journaux de la Métro ont dû être surpris de ne pas trouver de tribunes
des groupes politiques. Autant on peut comprendre que pour le numéro de juillet-août
ceci n’a pas pu se faire vu les délais de dépôt des groupes politiques issus
des élections municipales du 28 juin 2020.
Par contre pour le numéro
d’octobre, c’est incompréhensible de ne pas avoir ces expressions surtout après
tout ce qui s’est passé depuis l’élection contestée du président de la Métro le
17 juillet qui a vu un président se présentant de gauche et écologiste accepter
les voix de droite (LR er LREM) et d’extrême droite pour réussir à se faire
réélire président de la Métropole.
Cette publication est une
obligation imposée par le règlement intérieur du Conseil de métropole dans son
article 70 : « Les groupes d’élus disposent d’un espace identique
d’expression dans le bulletin d’information générale ainsi que sur le site de
Grenoble-Alpes Métropole. » Le
président de la Métro doit suivre cette prescription qui fait partie de la plus
élémentaire démocratie.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : communication, droit, Métro, presse
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 23 octobre 2020
Lors du conseil de métropole
du 16 octobre 2020, le président a rendu public le nouveau classement protocolaire
des 5 premiers vice-président-es qu’il a décidé par arrêté.
Michelle Veyret (1ère vice-présidente
à l’administration générale, aux ressources humaines et au patrimoine). Salima
Djidel (2e
vice-présidente, à la Santé, à stratégie et à la sécurité alimentaire). Raphaël
Guerrero, (3e
vice-président aux finances, à l’évaluation des politiques publiques et au
dialogue de gestion), Mélina Herenger, 4e vice-présidente au
Tourisme, à l’attractivité, l’Université, à l’innovation et à la qualité de vie.
Lionel Coiffard, 5e
vice-président à la prévention, la collecte et la valorisation des
déchets.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : droit, élections, justice administrative, métropole
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 6 septembre 2020
Les
lobbies économiques et financiers placés au sein du gouvernement ont décidé de
détruire le droit de l’environnement : par décret n°2020-412 du 8 avril
2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet, qui se perpétue au-delà
de la période d’urgence sanitaire, le gouvernement a autorisé les préfets à ne
pas respecter le droit de l’environnement en dérogeant à toute une série de
normes principalement environnementales : aménagement du territoire et
politique de la ville, environnement agriculture et forêt, construction de
logements, urbanisme, protection et mise en valeur du patrimoine culturel…
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : droit, environnement, état
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 25 juillet 2020
Il n’y a aucune raison pour
qu’un-e grenoblois-e ne puisse pas être élu-e président-e de la Métro.
Théoriquement dans un monde normal le choix de la personne doit s’opérer en
fonction de sa compétence à gérer une grande administration et en fonction des
choix politiques qu’il ou qu’elle porte.
Que ce soit notre
Constitution ou le droit européen rien n’autorise une discrimination d’une
personne en fonction de son appartenance à telle ou telle commune. Et pourtant
c’est ce qui a été fait le 17 juillet 2020 qui restera un jour sombre où on a
vu cette discrimination s’opérer.
Dans les semaines qui ont
précédé l’élection, quelques tentatives nauséabondes ont essayé d’indiquer que
Yann Mongaburu n’était pas la bonne personne pour cette fonction. Mais cela s’est
vite arrêté car les fonctions remplies ces dernières années par Yann Mongaburu
ont montré sa capacité à initier de très bonnes politiques pour le territoire,
en sauvant l’existence du SMTC lorsque le préfet a essayé de le dissoudre puis
en militant sans relâche pour la création du SMMAG, malgré de nombreuses
réticences, qui ne sont pas toutes levées.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : droit, élections, grenoble, métropole
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 3 juillet 2020
Pour convenances politiques
personnelles, le Président Macron a proposé un deal (complètement irrégulier)
aux présidents de Région. En échange de subventions supplémentaires il
proposait de décaler les élections Régionales et Départementales après
l’élection présidentielle, alors qu’elles doivent se dérouler en mars 2021. Le
motif politique réel était de lui éviter une nouvelle déroute électorale un an
avant l’élection présidentielle.
Le 29 mai
2020 l’ancien Premier ministre a tenu un autre discours devant les
députés lors des questions au gouvernement : « On
ne fixe pas la date des élections à sa convenance. C’est la loi qui fixe le
terme du mandat pour lequel un élu a été élu… dans l’hypothèse où un motif
d’intérêt général justifie que la durée d’un mandat soit allongée, il est
possible de reporter la date prévue de l’élection… sous le contrôle du juge
constitutionnel »
Devant de telles méthodes, Raymond Avrillier a saisi la justice. Voir le communiqué d’Anticor du 26 juin 2020 :
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : constitution, droit, élections, état, libertés
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 26 juin 2020
Le projet de loi sur la sortie de l’état d’urgence qui est discuté au Parlement ne prévoit pas l’abandon total des mesures exceptionnelles prises ces derniers mois : au risque de glisser progressivement vers un mode de gouvernement par l’exception. De nombreuses voix s’élèvent contre ce projet de loi. Un groupe d’associations, de syndicats, d’universitaires et d’avocat·es, membres du réseau de veille sur l’état d’urgence sanitaire, souhaitent alerter sur la dangerosité de ce projet, au regard des atteintes aux droits et libertés qu’il comporte :
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : constitution, droit, libertés
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 26 juin 2020
Vu le nombre de propositions d’installation de caméras intelligentes ou thermiques pour soi-disant sécuriser le déconfinement, le 17 juin, la CNIL alerte sur les dérives potentielles. Elle appelle les pouvoirs publics à mieux encadrer ces dispositifs, l’expression du consentement des personnes filmées s’avérant particulièrement problématique, en effet la CNIL reconnaît qu’il y a un vide juridique sur les caméras intelligentes pour l’expression du consentement.
Le développement incontrôlé
de ces systèmes présente le risque de généraliser un sentiment de surveillance
chez les citoyens, de créer un phénomène d’accoutumance et de banalisation de
technologies intrusives, et d’engendrer une surveillance accrue, susceptible de
porter atteinte au bon fonctionnement de notre société démocratique. Fondées
sur la captation d’images d’individus, ces caméras contribuent selon
elle à rompre l’anonymat dans l’espace public et entravent la liberté
d’aller et de venir en s’immisçant dans les transports, les commerces et les
lieux de travail.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : droit, libertés, technos, videosurveillance
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 19 juin 2020
Le 9 avril 2020, des journalistes de Médiapart demandent à Santé publique France (SPF) la communication de tous les contrats passés par SPF depuis le 1er mars 2020 avec ses fournisseurs officiels, à savoir les entreprises Segetex-EIF, Aden Services, Fosun et BYD.
Santé publique France a répondu par courriel,
lundi 5 juin, en rejetant leur demande : « Les contrats
d’achats de masques sont confidentiels car ils relèvent du secret des affaires,
nous ne sommes pas en mesure de transmettre de tels documents ».
Ces éléments permettraient de savoir quand SPF
a passé commande et pour quelles quantités ? Même ces informations ne
figurent pas dans les éléments publiés pour l’instant par la mission
d’information de l’Assemblée nationale sur la gestion de la crise sanitaire.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : droit, état, presse, santé
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 19 juin 2020
Le 15 mai nous avions indiqué que la loi adoptée sur proposition de la députée Avia, mettait lourdement en cause la liberté d’expression et que nous espérions que des parlementaires feraient vérifier par le Conseil Constitutionnel la non-conformité de cette loi avec les principes de notre République.
Le 18 juin le Conseil Constitutionnel rend sa décision
et c’est l’annulation de très nombreux articles de cette loi.
« Tout en réaffirmant que la Constitution permet au législateur de réprimer les abus de la liberté d’expression et de communication, le Conseil constitutionnel censure des dispositions portant à cette liberté des atteintes qui ne sont pas adaptées, nécessaires et proportionnées.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : constitution, droit, libertés
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 12 juin 2020
Edouard Philippe a fait un oubli regrettable lorsqu’il a déclaré le 9 juin à Evry, en voulant citer la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, suite aux manifestations d’opposition à la violence policière : « les hommes naissent libres et égaux en droit ». Or, dans son article 1er la Déclaration indique que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits… ».
Cet oubli du premier Ministre n’est pas anodin ! Il mérite d’être souligné et que nous ne l’oublions jamais, car ce n’est pas tant au moment de la naissance que les injustices et les inégalités sont manifestes, mais juste après, selon le lieu d’habitation et la carte scolaire, l’environnement quotidien dans lequel on vit. Il arrive même que dans ces quartiers dits « quartiers prioritaires politique de la ville » les jeunes et les moins jeunes finissent par se quereller plus ou moins gravement, pour des morceaux de territoires « à préserver », des histoires amoureuses qui tournent mal, des manifestations bruyantes par l’intrusion d’engins motorisés dans les endroits piétonniers, c’est donc tous contre tous !
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : constitution, droit, état, france, libertés
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 12 juin 2020
Le 8 juin, le Défenseur des droits a publié son rapport d’activité pour l’année 2019. Le nombre des réclamations adressées au Défenseur des droits a été en hausse l’an dernier. Les inégalités territoriales et l’accès aux services publics font pour lui, partie des enjeux prioritaires à traiter. La crise sanitaire est venue amplifier cette année ces problèmes. C’est le dernier rapport rédigé par J. Toubon qui quitte ce poste en juillet prochain.
En 2019, le Défenseur des
droits a reçu 103.000 réclamations, soit 7,5% de plus que l’année précédente.
Depuis 2014, les demandes ont bondi de 40,3%. Elles concernent majoritairement
les relations avec les services publics – plus de 60.000 réclamations, en
hausse de 10,4% sur un an. Le rapport dépeint les inégalités territoriales,
mais aussi le sentiment d’abandon provoqué par « la fracture numérique
et la dématérialisation à marche forcée » des services publics. Faute
de moyens, ceux-ci ont des difficultés croissantes à répondre aux demandes : « Les
61.596 réclamations liées aux relations avec les services publics reçues par
l’institution cette année confirment l’ampleur des effets délétères de
l’évanescence des services publics sur les droits des usagers » et « le
recul de la présence humaine aux guichets ».
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : droit, france, inégalités, services publics
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 29 mai 2020
Le 26 mai le Conseil d’Etat a saisi le Conseil Constitutionnel d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) concernant l’article 19 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ! Cet article validait les résultats du 1er tour des municipales et renvoyait le second tour avant la fin juin 2020. Lors d’une contestation électorale du premier tour d’une élection municipale, un requérant a posé une QPC au Conseil d’Etat qui a décidé que la question était sérieuse et que les dispositions de l’article 19 pouvaient porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de sincérité du scrutin.
Le professeur Romain Rambaud, de l’Université de Grenoble-Apes, spécialiste du droit électoral analysait le 26 mai cette situation inédite sur « le blog du droit électoral », en voici l’introduction :
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : constitution, droit, élections
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 22 mai 2020
Le décret n° 2020-548 pris le 11 mai 2020 par le
Premier ministre prescrit dans son article 10 que pendant la durée du
confinement, tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte
est interdit, à l’exception des cérémonies funéraires, qui sont limitées à vingt
personnes.
Des
associations et des personnes ont attaqué cette décision devant le Conseil d’Etat
en déposant des référés liberté estimant que cette partie du décret mettait en
cause une liberté fondamentale. Le juge des référés a donné raison aux requérants
et des réunions respectant les exigences sanitaires pourront de nouveau avoir
lieu dans les lieux de culte.
Voici le
communiqué du Conseil d’Etat du 18 mai 2020 :
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : culte, droit, justice administrative, santé
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 15 mai 2020
Le 9 mai,
le parlement a adopté la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10
juillet inclus. Cette loi n’a pas pu être promulguée à temps par le Président
de la République à temps ; le Conseil Constitutionnel ne l’a que
partiellement validée le 11 mai, il a été sollicité en urgence le 9 mai par le
Président de la République et le Président du Sénat et le 10 mai par des
députés et des sénateurs.
La loi est
parue au Journal officiel le 12 mai, sans son article 13 déclaré non conforme à
la Constitution.
« Le Conseil
constitutionnel a censuré comme méconnaissant la liberté individuelle l’article
13 de la loi déférée qui a pour effet, à compter de l’entrée en vigueur de la
loi déférée, de laisser subsister, au plus tard jusqu’au 1er juin 2020, le
régime juridique actuellement en vigueur des mesures de mise en quarantaine et
de placement et maintien à l’isolement en cas d’état d’urgence
sanitaire. »
Ce qui
posait le plus de questions dans ce projet de loi étaient les mesures de
traçage et de recueil des contacts des personnes infectées qui portaient
atteintes aux droits et libertés individuelles.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : constitution, droit, libertés
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 1 mai 2020
Le 24 avril 2020, la cour d’appel de Versailles a
rendu un arrêt qui confirme en grande partie l’ordonnance du tribunal de Nanterre
du 14 avril ; les syndicats de l’entreprise avaient donc raison d’attaquer
leur employeur qui les mettait en danger.
« Les premiers juges
doivent être suivis lorsqu’ils rappellent fermement à la société Amazon sa
responsabilité dans la sauvegarde de la santé de ses salariés dans l’actuelle
période d’urgence sanitaire, […] que
les services de santé sont surchargés face à la propagation de l’épidémie et
que toute personne est un vecteur potentiel de la transmission du virus
La cour d’appel a un peu élargi
les produits que pourrait commercialiser Amazon, en incluant les produits
« high-tech, d’informatique et de bureau », les produits « pour les
animaux », les produits « santé et soins du corps », « nutrition »
et de « parapharmacie », ainsi que les produits « d’épicerie,
boissons et entretien ».
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : droit, économie, santé
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 24 avril 2020
On
apprend par la presse que des inspecteurs du travail se rebellent face aux
pressions de leur ministre. Depuis l’arrivée de Mme Pénicaud au ministère du Travail,
en 2017, ses relations avec les inspecteurs du travail n’ont jamais été
reluisantes. Un dialogue quasi inexistant et le maintien d’une politique de
contrainte des effectifs n’y ont pas aidé. A la faveur de la crise sanitaire et
économique, la situation s’envenime pour de bon. Il s’agit de l’indépendance
des inspecteurs, normalement garantie par les conventions de l’Organisation
internationale du travail (OIT), signées par la France.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : droit, justice administrative, Sécurité
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 17 avril 2020
L’Union syndicale Solidaire et
les Amis de la Terre viennent d’obtenir de la justice (Tribunal Judiciaire de
Nanterre) que la société Amazon ne puisse vendre que des marchandises
essentielles à savoir l’alimentaire, l’hygiène et le médical et cela sous astreinte
d’un million d’euros par jour de retard de prise en compte de cette exigence.
Il semble que la justice judiciaire prenne mieux en compte les atteintes aux
libertés et aux risques pour les personnels que la justice administrative, il
est vrai que notre Constitution en son article 66 donne mission à l’autorité judiciaire
d’être la gardienne de la liberté individuelle.
Amazon a décidé de fermer
temporairement ses sites pour examiner comment prendre en compte cette décision
de justice.
Voici le communiqué du 14 avril
du syndicat :
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : droit, emploi, santé
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |