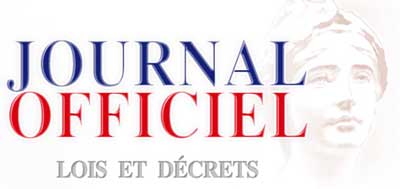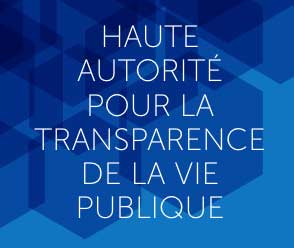Archives pour le mot-clef ‘état’
Publié le 8 octobre 2021
Le 4 octobre 2021, la cour des comptes rend public un rapport sur un premier bilan de la réforme du groupe Action Logement créé par une ordonnance de 2016.
La participation des employeurs à l’effort de construction (Peec) avait été instaurée en 1953 pour remédier à l’insuffisance de logements du fait des destructions de la deuxième guerre mondiale et de l’absence d’une politique en faveur du logement social dans l’entre-deux guerres (c’était le fameux 1% patronal). Ce prélèvement, établi à 0,45 % depuis 1991, représente aujourd’hui une contribution obligatoire de 1,7 Md€ imposée aux entreprises de plus de 50 salariés.
En 2016 il y a la création du groupe Action logement pour mettre fin à une organisation éclatée et insuffisamment contrôlée de la gestion de ce prélèvement. Action Logement contrôle plus de 50 filiales immobilières possédant près d’un million de logements – soit plus de 20 % du parc national de logements sociaux. C’est donc un opérateur de tout premier plan dans la gestion du logement social et est même devenu le financeur obligé notamment de l’ANRU.
Le relèvement par la loi Pacte de mai 2019 des seuils d’assujettissement aux entreprises comptant plus de cinquante salariés a abouti à ce que 80 % des entreprises de plus de dix salariés (représentant 40 % de l’ensemble des salariés) qui constituaient précédemment une part importante des entreprises contributrices, sont désormais extérieures au dispositif.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : état, logement, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 1 octobre 2021
Le projet de loi de finances 2022 a été arrêté au conseil des ministres du 22 septembre 2021. Après les critiques du Haut Conseil des Finances Publiques et celles des associations environnementales, et de toutes celles et de tous ceux qui avaient espéré dans les travaux de la Convention Citoyenne sur le climat, même l’Association des Maires de France ne mâche pas ses mots en déclarant que ce budget ne répond pas aux exigences de la transition écologique et que la fameuse hausse de 3% du budget du ministère de l’écologie était en trompe-l’œil ! Et que ce budget était très loin des attentes des collectivités.
La somme de 50 milliards est certes importante, mais il ne faut pas oublier que le ministère de la Transition écologique chapeaute aujourd’hui bien d’autres activités que la seule transition écologique. Il a en particulier absorbé, depuis le remaniement de 2020, le ministère du Logement.
C’est d’ailleurs bien le budget du logement qui, dans le total, pèse le plus lourd : il drainera en 2022, à lui seul, plus de 17 milliards d’euros. Une grande partie de ce budget (13,1 milliards) ira aux aides et à l’accès au logement – ce qui, à proprement parler, n’a pas grand-chose à voir avec de la transition écologique.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : budget, collectivités, écologie, état
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 1 octobre 2021
Le gouvernement prépare une ordonnance pour simplifier les règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il s’agit donc d’une réforme très importante puisque ces règles fondent l’effectivité des décisions et le contrôle de leur légalité soit par le préfet soit par la justice administrative en cas de recours.
L’article 78 de la loi du 27 décembre 2019 prévoit que « dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation ainsi qu’au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d’harmoniser ces règles et de recourir à la dématérialisation. »
Le délai pour prendre cette ordonnance est fixé au 27 octobre 2021.
Pour se prononcer sur ces simplifications, il faudra connaitre le détail de l’ordonnance et du décret qui l’accompagnera. La majeure partie des changements sera dominée par la dématérialisation de nombreux actes des collectivités.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : collectivités, état, publicité
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 24 septembre 2021
Le 22 septembre, le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a rendu un avis très critique sur le projet de la loi de finances 2022 arrêté par le gouvernement. Le HCFP est une institution budgétaire indépendante du Gouvernement et du Parlement. Pour lui le projet est incomplet et en conséquence il n’a pas pu rendre un avis éclairé sur ce projet.
On peut donc douter de la sincérité de ce projet de loi de finances, or la sincérité budgétaire est un principe reconnu par la Constitution : « Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères… » (Article 47-2).
Le HCFP n’y va pas par quatre chemins :
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : budget, état, FInances
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 24 septembre 2021
La politique gouvernementale concernant la lutte contre l’économie parallèle dominée par la vente de stupéfiants est totalement à la ramasse. Il avait été décidé d’expérimenter la mise en place des amendes forfaitaires délictuelle (AFD) pour éviter que les consommateurs ou dealers pris la main dans le sac, passent au tribunal et ainsi accélérer la répression et espérer faire diminuer le trafic. Mais là aussi c’est un échec patent, la plupart des amendes ne sont pas recouvrées.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a étendu la possibilité de recourir à l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour réprimer l’usage de stupéfiants. Sa mise en œuvre a débuté le 16 juin 2020 par une expérimentation sur les ressorts des tribunaux judiciaires de Créteil, Reims, Rennes, Lille et Marseille. Elle a été généralisée à l’ensemble du territoire dès le 1er septembre 2021
Les chiffres officiels donnés par le gouvernement justifient la légalisation du cannabis, vu l’incapacité de la répression à contenir ce phénomène et seul moyen pour casser l’économie parallèle qui gangrène de nombreux territoires, légalisation accompagnée par une politique de prévention dynamique.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : drogues, état, répression, santé
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 24 septembre 2021
Le Conseil d’État somme l’État de respecter le délai d’enregistrement en Île-de-France pour les demandes d’asile. Dans un arrêt du 30 juillet 2021, la haute juridiction hausse le ton et menace désormais l’État de lui imposer une astreinte s’il ne prend pas, dans un délai de quatre mois, les mesures susceptibles d’améliorer la situation. Lire les conclusions du rapporteur public sur l’arrêt n°447339.
Les collectivités locales vont désormais intégrer l’UICN. Lors du congrès mondial de la nature, qui se tenait à Marseille, après de longues discussions, les membres de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ont enfin accepté que les collectivités locales puissent elles aussi faire partie intégrante de cette organisation.
Les collectivités locales peinent à recruter. Le 12e baromètre RH des collectivités locales analyse les difficultés rencontrées par les employeurs territoriaux pour embaucher les agents dont ils ont besoin. Le manque d’attractivité de certains postes et les rémunérations jugées trop faibles constituent les principaux freins au renforcement des effectifs.
Un décret pour réduire la mise en décharge des déchets non dangereux. Pour obliger la valorisation des déchets un décret et un arrêté parus ce 18 septembre fixent la procédure de contrôle ainsi que les modalités de justification du respect des obligations de tri avant élimination et leur mise en place progressive.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : collectivités, déchets, état, immigration, Nature
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 11 septembre 2021
Des décrets du 2 septembre 2021 mettent en place l’encadrement des loyers sur une petite partie du territoire des métropoles de Lyon, Montpellier et Bordeaux. Ce sont seulement les communes de Lyon, Villeurbanne, Montpellier et Bordeaux qui sont concernées. Avec Paris, Lille (avec les communes de Lomme et d’Hellemmes) et l’établissement public territorial Plaine Commune en Seine-Saint-Denis, il y a neuf collectivités qui sont couvertes par ce dispositif expérimental fixé par l’article 140 de la loi Elan, dispositif qui dure jusqu’à fin novembre 2023 mais sera peut-être prolongé de trois ans.
La proposition de la Métropole de Grenoble a été refusée par la ministre du logement de manière surprenante, soi-disant que les loyers ne sont pas assez élevés ! Or il y a des zones dans l’agglomération en particulier à Grenoble où les loyers sont en tension et élevés. Le gouvernement pouvait très bien limiter la zone d’expérimentation au lieu de rejeter la demande en bloc. Grenoble est dans le viseur politique du gouvernement et la députée de droite Chalas a tout fait pour bloquer cet encadrement qui aurait été une mesure sociale pertinente.
La mairie de Grenoble a fait un communiqué le 3 septembre pour s’étonner de ce refus :
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : état, grenoble, loyers, métropole, spéculation
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 11 septembre 2021
Un décret du 30 août précise l’essentiel de la réforme des modes d’accueil de la petite enfance, en préparation depuis près de deux ans et annoncée par l’ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles. Le gouvernement fait régresser la qualité de l’accueil et des conditions de travail dans ce secteur.
Le décret traite notamment des obligations des assistantes maternelles en matière de déclaration de leurs places disponibles, des traitements et soins médicaux des enfants pris en charge par des professionnels d’un mode d’accueil du jeune enfant, de la réglementation commune aux établissements d’accueil du jeune enfant et des crèches collectives.
Cette réforme a fait réagir fortement « Pas de bébés à la consigne » regroupement de très nombreuses associations, syndicats et professionnels de la petite enfance, qui milite pour une politique publique ambitieuse pour la petite enfance permettant aux familles qui le souhaitent d’accéder à un mode d’accueil de qualité sans barrière financière, car c’est la première condition pour assurer le droit au travail des femmes.
Il faut souhaiter que les collectivités locales résistent à certaines dispositions, qui peuvent dégrader fortement la qualité du service, notamment sur l’encadrement des enfants. Elles devront mettre en place des supervisions des équipes de crèche ce qui est positif et l’inscription de la charte petite enfance qui peut devenir une bonne base pour travailler le projet pédagogique des crèches municipales.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : enfance, état, Mobilisations, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 28 août 2021
Le 14 août, Emmanuel Macron, tellement soucieux de préparer sa campagne présidentielle, très orientée à droite, a oublié qu’en tant que Président de la République il doit donner l’exemple en appliquant les règles du droit international concernant l’asile des réfugiés. Ces règles ont été ratifiées par la France, à travers la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) qui se réfère à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
Ce sont les articles 13 et 14 de la Déclaration universelle qui fondent les règles du droit d’asile.
Article 13.
- Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État.
- Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14.
- Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
- Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Le droit d’asile n’est pas concevable sans la possibilité de quitter son pays, donc de franchir une frontière internationale et d’entrer dans un autre pays.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : droits des étrangers, état, international, réfugiés
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 28 août 2021
Les distances minimales d’épandage des pesticides autour des habitations devront être augmentées pour les substances dont la toxicité n’est que suspectée et l’information des riverains organisée dans les chartes d’engagements en amont de leur pulvérisation. Suite à l’arrêt du 26 juillet 2021, le gouvernement dispose de six mois pour remettre sa copie.
Le Conseil d’État juge que la réglementation attaquée par de nombreux requérants, associations, collectivités et personnes physiques, fixe des distances de sécurité insuffisantes et ce en méconnaissance du principe de précaution.
Le Conseil d’État ordonne de compléter la réglementation en vigueur pour mieux protéger la population sur trois points :
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : état, justice administrative, pollution, santé
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 28 août 2021
La suppression de l’Observatoire de la laïcité et son remplacement par un comité interministériel de la laïcité, présidé par le Premier ministre, est un mauvais coup. Alors que l’Observatoire était une commission administrative consultative qui avait une autonomie par rapport à l’exécutif, son remplacement par une structure gouvernementale purement politique supprime la fonction de conseil de l’Observatoire.
En plein mois d’août, le gouvernement a supprimé l’accès au site internet de l’Observatoire qui est une mine de renseignements et d’aide notamment aux enseignants. L’ancien site laicite.gouv.fr renvoie aux services du Premier ministre !
L’ancien président de l’Observatoire a critiqué cette fermeture : “Que le gouvernement ait supprimé l’Observatoire de la Laïcité ne l’obligeait pas à supprimer son site internet. C’était un des plus visités de la plateforme gouvernementale. Il aidait quotidiennement les acteurs de terrain de la laïcité”.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : état, laïcité
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 16 juillet 2021
Le 28 juin 2021, la commune de Grenoble avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble pour enjoindre au préfet de l’Isère de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin d’assurer l’hébergement des personnes se trouvant actuellement dans le campement situé rue Jean Macé à Grenoble et dont l’expulsion a été ordonnée par une décision du tribunal judiciaire de Grenoble.
Le 13 juillet le juge des référés a rejeté la demande de la Ville, car le préfet a pris les mesures nécessaires pour l’hébergement d’urgence de toutes les personnes expulsées.
Comme quoi l’action de la ville a accéléré la solution de l’hébergement d’urgence, sauf que de nombreuses personnes du squat ont disparu dans la nature puisqu’il ne restait que 39 personnes à expulser.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : état, grenoble, hébergement, justice administrative, précarité
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 9 juillet 2021
Alors que la Ville, soutenue par la Métro, avait proposé depuis de longues semaines à la préfecture des locaux pour des hébergements d’urgence pour reloger les personnes qui squattent des bâtiments dans le quartier Jean Macé, dans des situations inadmissibles du point de vue de l’hygiène, la salubrité et la sécurité. Pour la Ville, il faut garantir la mise à l’abri des personnes dont la vulnérabilité n’est pas à démontrer.
Mais la préfecture ne bouge pas.
La Ville de Grenoble a donc décidé d’en appeler à la justice en déposant un référé pour mesures utiles au tribunal administratif de Grenoble pour faire bouger la préfecture, estimant qu’il y a urgence.
L’audience aura lieu le 13 juillet 2021.
Selon l’article L521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : état, immigration, justice administrative, mairie, métropole, précarité, solidarité
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 9 juillet 2021
Le dispositif d’encadrement des loyers dans les zones tendues, régit par un décret du 27 juillet 2017 modifié, s’applique à 28 agglomérations, dont celle de Grenoble. Il s’agit des zones d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel.
Un décret du 29 juin 2021 prolonge, à nouveau, l’application de l’encadrement des loyers à la relocation dans ces agglomérations jusqu’au 31 juillet 2022.
Rappel du principe d’encadrement des loyers : si aucune révision de loyer n’est intervenue au cours des douze mois précédant la conclusion du nouveau contrat de location, le loyer appliqué au nouveau locataire ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire, révisé en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : état, logement, loyers, revenus
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 2 juillet 2021
La commune de Grande-Synthe soutenue par les villes de Paris et Grenoble ainsi que par plusieurs organisations de défense de l’environnement dont Oxfam France, Greenpeace France, Notre Affaire A Tous et la Fondation Nicolas Hulot, a gagné ses recours contre le gouvernement concernant l’insuffisance des décisions prises pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Après la décision du 19 novembre du Conseil d’Etat, qui demandait à l’Etat de justifier sous 3 mois que la trajectoire de réduction à horizon 2030 pourra être respectée, le 1er juillet 2021 il annule le refus d’agir du gouvernement et il enjoint au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires avant le 31 mars 2022, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Si le gouvernement n’agit pas d’ici le 31 mars 2022, le Conseil d’Etat pourrait décider d’une astreinte financière pour l’obliger à agir.
Voici le communiqué du Conseil, d’Etat du 1er juillet :
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : conseil, état, france, pollution atmosphérique
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 2 juillet 2021
Il aura fallu presque 3 ans pour que la justice administrative bloque définitivement les décisions du gouvernement autorisant par arrêté la chasse à la glu de grives et de merles noirs dans certains départements.
Après avoir, en 2018, validé une chasse d’oiseaux à la glu, le Conseil d’Etat a enfin en 2019 posé la question de cette compatibilité au juge européen et suite à la réponse de la Cour de justice européenne, il a enfin jugé illégale ce type de chasse.
Le 28 juin 2021, par trois arrêts (n° 443849, 434365 et 425519), le Conseil d’Etat a définitivement annulé les dérogations accordées par l’Etat pour cette chasse, jugée contraire au droit européen selon la directive « Oiseaux » du 30 novembre 2009.
Voici le communiqué du Conseil d’Etat qui résume ces décisions :
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : biodiversité, conseil, état, Europe
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 2 juillet 2021
La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié le bilan des déclarations d’activité des représentants d’intérêts (lobbyistes). Pour l’instant, seules les actions de lobbying vis-à-vis du Parlement et du gouvernement sont comptabilisées. Dans un an, celles qui s’adressent aux collectivités territoriales le seront aussi.
Sur les 2 333 représentants d’intérêts inscrits au répertoire numérique géré par la Haute Autorité, 1 849 avaient jusqu’au 31 mars 2021 pour déclarer leurs activités de représentations d’intérêts effectuées en 2020, ainsi que les moyens alloués à ces actions.
50 % ont effectué une déclaration dans le délai légal, un résultat en nette progression par rapport à l’exercice précédent (34 %) mais encore insatisfaisant. Après relances amiables, ce taux de dépôt s’élève à 85 %, contre 90 % en 2019.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : économie, état, transparence
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 14 mai 2021
Ce projet de la ZAC INSPIRA est
à revoir complètement. La volonté de la majorité du département de l’Isère, du
préfet et des lobbies se heurtent tout de même aux règles de notre République.
Il ne suffit pas de radier un commissaire-enquêteur qui a fait son travail
d’analyse du dossier, en toute indépendance, pour que ce projet arrive à
s’imposer.
L’Autorité environnementale (Ae) en est à son 4ème avis qui a été délibéré le 5 mai 2021.
Voici la synthèse de cet avis qui
indique les nombreuses insuffisances de l’étude d’impact :
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Conseil Départemental de l'Isère, environnement, état
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 14 mai 2021
Mieux préparer les prochains contrats de plan État-régions concernant le climat. L’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) édite un rapport qui tire plusieurs enseignements pour les prochains contrats 2021-2027 en cours de négociation et formule plusieurs points de vigilance, notamment dans le domaine des transports. Le montant prévu de ces contrats est de 40 milliards, ; il faudrait qu’ils s’inscrivent dans la stratégie bas-carbone qui n’est pas suivie par la politique gouvernementale.
Rapport du déontologue de l’Assemblée nationale pour l’année 2020. Il traite du contrôle des frais de mandat, de l’encadrement du lobbying, du statut des collaborateurs parlementaires à l’Assemblée nationale et de la prévention des conflits d’intérêts et du registre des déports. En conclusion, l’Assemblée nationale est encore loin d’avoir achevé la « révolution déontologique » promise par la majorité en début de mandat.
Plan national santé environnement. Autour de 4 axes : s’informer, se former et informer sur l’état de notre environnement et les bons gestes à adopter pour notre santé et celle des écosystèmes ; réduire les expositions environnementales affectant la santé humaine et celle des écosystèmes sur l’ensemble du territoire ; démultiplier les actions concrètes menées par les collectivités dans les territoires ; mieux connaître les expositions et les effets de l’environnement sur la santé des populations et sur les écosystèmes.
Bilan positif pour les salles de shoot. Des toxicomanes en meilleure santé, un coût raisonnable et un impact neutre sur la tranquillité publique : cinq ans après leur création, les salles de consommation à moindre risque démontrent leur efficacité, selon une étude publiée par l’Inserm.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : climat, environnement, état, parlement, région, santé
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |