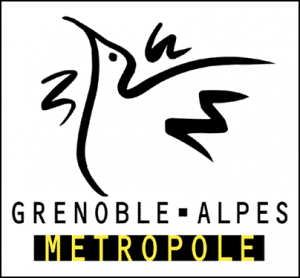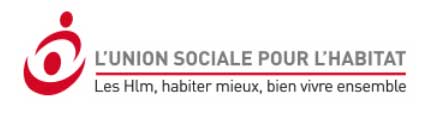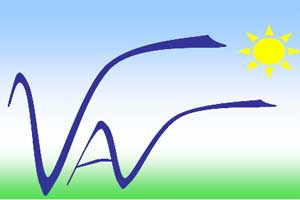Archives pour le mot-clef ‘social’
Publié le 17 décembre 2021
Le bureau d’ACTIS avait décidé récemment de ne pas se rapprocher de la SEM Grenoble Habitat pour des raisons qui restent toujours obscures et essentiellement liées à la défense corporatiste d’un statut et non pour des raisons politiques de fond sur la question essentielle du logement social et du logement pour tous. Le Conseil d’administration d’ACTIS, après avoir décidé d’un rapprochement avec Grenoble Habitat, abandonne cette idée. Il aurait été plus simple et clair d’expliquer que puisque le président de la Métro ne voulait plus acheter les actions de la SEM Grenoble Habitat, la solution du rapprochement prévu était abandonnée. Le CA d’ACTIS indique qu’il pourrait rejoindre soit une SAC existante soit une nouvelle SAC.
La SAC existante regroupe les OPH du département et de Vienne, la Société de coordination entre Rhône et Alpes (SCEREA), qui existe depuis un an et qui a obtenu l’agrément ministériel le 8 février 2021. ACTIS serait minoritaire dans cette SAC.
La SAC à créer, consisterait à se rapprocher de la petite SEM LPV (le Logement du Pays de Vizille) contrôlée par la commune de Vizille et Procivis, solution qui est plus compliqué (même peut-être à exclure à court terme), pour former une SAC d’un peu plus de 12 000 logements. LPV faisant déjà partie d’un groupement.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : grenoble, logement, métropole, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 10 décembre 2021
Alors que la diminution du temps de travail est une évolution historique qu’il faut poursuivre, la majorité parlementaire a imposé une loi qui remet en cause ce qui avait permis d’adapter les horaires de travail dans les collectivités locales. A Grenoble le temps de travail des agents était depuis de longues années de 1579 h, soit 28 h de moins que les 1607 heures imposées par la nouvelle loi, soit 1,7 % de moins.
La rapportrice de la loi était Mme Chalas, bien connue à Grenoble et très volontaire pour tout recentraliser, aux ordres de Jupiter-Macron.
Alors que la Constitution impose la libre administration des collectivités, voilà que le pouvoir central ne veut voir qu’une seule tête dans tout le pays.
Personne ne pourra croire qu’obliger les agents à travailler ces 28 heures de plus, étalées sur toute l’année, va apporter des progrès significatifs dans l’activité globale de la ville. La productivité dépend beaucoup plus de la qualité de l’organisation détaillée du travail dans les différents services plutôt que d’une augmentation ridicule de 1,7 %, du temps de travail. Il s’agit ni plus ni moins d’une punition, qui veut simplement rappeler que c’est le gouvernement qui décide de tout, partout.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : collectivités, conseil municipal, emploi, grenoble, loi, métropole, parlement, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 10 décembre 2021
La politique gouvernementale contre le logement social poursuit ses dégâts notamment dans notre agglomération. La mise en place en 2018 de la RLS (réduction du loyer de solidarité) permet à l’Etat d’économiser sur les APL versées aux locataires du logement social. Elle met les bailleurs dans une situation financière délicate, tout particulièrement les bailleurs dont le patrimoine de logements dans les quartiers politique de la ville (QPV) est important, comme ACTIS.
Puis la deuxième lame du rasoir est l’obligation du regroupement des bailleurs qui ont moins de 12 000 logements à gérer, comme ACTIS qui a donc l’obligation de se regrouper avec un autre bailleur avant fin décembre 2021.
Lors du mandat précédent à la Métro, un travail prospectif a été fait pour savoir quel serait le meilleur outil public pour porter une politique sociale du logement dans l’agglomération avec les nouvelles contraintes imposées par le pouvoir macronien.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : logement, métropole, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 3 décembre 2021
L’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Uncass) publie un livre blanc sur l’autonomie. Les CCAS sont des acteurs importants dans la prévention de la perte d’autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées. Ce livre blanc se situe dans un contexte particulier : celui de l’abandon du projet de loi Autonomie, officialisé en septembre dernier. L’introduction du livre blanc rappelle en effet qu’en son temps, l’Uncass avait salué l’ambition de ce texte proposant des réformes structurantes pour une nouvelle politique du grand âge aux niveaux national et local, qui devait faire l’objet d’une traduction efficace et concrète dans une loi à venir. Tout en reconnaissant des avancées comme la création de cette « cinquième branche atypique » l’association déplore l’abandon du projet de loi
« LES PRINCIPAUX POINTS D’INTENTIONS DU LIVRE BLANC AUTONOMIE
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : personnes âgées, social, solidarité
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 5 novembre 2021
La commission chargée de faire des propositions sur « la relance durable de la construction« , présidée par F. Rebsamen, a remis le 28 octobre le deuxième tome de son rapport. Intitulé : « Approfondissement du contrat local et autres mesures nationales ».
La commission avait remis au premier ministre, le 22 septembre dernier, le premier tome de son rapport qui préconisait notamment une compensation intégrale de la TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) pour le logement social et intermédiaire. Quelques semaines après, le gouvernement annonçait qu’il appliquerait cette proposition mais seulement à titre temporaire.
Dans le deuxième tome, le rapport formule 24 propositions concernant, notamment le contrat local de relance du logement. Il évoque des mécanismes d’équité dans l’effort de construction, d’accélération des procédures contentieuses, de transformation de bureaux en logements, de foncier solidaire, de ZAC ou encore de mobilisation des logements vacants.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : logement, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 29 octobre 2021
Dans une étude d’octobre 2021 intitulée : « Dépenses sociales et médico-sociales des départements en 2020 un nouveau cycle inquiétant s’ouvre en 2020 », l’Observatoire national de l’action sociale (ODAS), avec la Banque Postale, attire l’attention sur la dérive des dépenses sociales des département.
En 2020, la dépense nette d’action sociale départementale a augmenté de 1,6 milliards d’euros par rapport à 2019 (soit +4,2%), passant de 38,6 à 40,2 milliards d’euros. La participation financière de l’Etat est restée presque stable par rapport à 2019 (+1,4%). La charge nette progresse de 1,5 milliards d’euros par rapport à 2019 pour atteindre 31,8 milliards d’euros (+5,1%). Ces augmentations de la dépense nette et de la charge nette sont deux fois plus importantes que l’année précédente.
L’ODAS craint que ces dérives des dépenses se poursuivent en 2022 et 2023.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : conseil départemental, Conseil Départemental de l'Isère, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 22 octobre 2021
On est toujours sans nouvelle de la mise en place d’un rapprochement entre ACTIS et la SEM Grenoble Habitat, conditionnée par une prise de participation de la Métro dans le capital de la SEM en rachetant les 2/3 des actions de la ville de Grenoble.
Puisqu’un certain nombre de personnes contestent l’estimation de la valeur des actions que détient la ville de Grenoble dans le capital de la SAEML Grenoble Habitat, il n’est pas inutile de rappeler les règles indiquées par le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) regroupant les lois et décrets qui gouvernent les acteurs du logement social, que ce soient les organismes HLM (dont les offices publics de l’habitat) ou les SEM agréées.
Le CCH traite des différentes possibilités d’absorption d’un organisme par un autre. Il précise qu’un office public de l’habitat peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine par exemple à une SEM. Ce transfert est reconnu d’intérêt général mais est nié par les opposants à la construction de l’outil métropolitain sur la base d’une SEM.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : grenoble, logement, métropole, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 8 octobre 2021
Pour restructurer le logement social et l’obliger à se réorganiser dans de grands ensembles pour permettre à l’Etat de faire des économies en diminuant les APL (aide personnalisé au logement) versées aux locataires du logement social, la loi Elan de 2018 a inventé la réduction du loyer de solidarité (RLS).
L’Etat diminue l’APL des locataires aux revenus faibles et impose au bailleur social de diminuer d’autant le loyer. C’est une opération blanche pour le locataire mais c’est une perte sèche pour le bailleur et surtout pour les bailleurs qui accueillent les ménages dont les revenus sont les plus bas, donc ceux qui sont fortement présents dans les QPV, comme ACTIS.
La RLS à partir du 1er octobre est multipliée par environ 1,65 par rapport à la situation du démarrage en 2018 ! L’arrêté qui fixe les nouveaux barèmes est valable jusqu’au 31 décembre 2021.
En 2020, la perte sèche pour ACTIS était de 3,6 M€. Pour 2022 elle pourrait atteindre 4 M€.
C’est extrêmement violent puisque par locataire atteint par la RLS cela va représenter 13 % du loyer.
<article mis à jour le 11/10/21>
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : logement, loyers, social, solidarité
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 8 octobre 2021
Le mouvement HLM, à l’occasion du 81ème congrès de l’Union Sociale de l’Habitat, qui s’est tenu à Bordeaux, appelle l’Etat et les collectivités locales à prendre la mesure de la crise du logement.
Le mouvement HLM rappelle les difficultés que la politique gouvernementale a créées et qui sont les raisons profondes du ralentissement très important de la construction de logements sociaux, notamment les mesures budgétaires subies par les organismes HLM depuis plus de 3 ans : taux de TVA augmenté de 5,5% à 10% pour le PLUS et le PLS alors que le logement est un bien de première nécessité, baisse des APL et Réduction du Loyer de Solidarité…
La RLS vient d’être augmentée violemment (voir article à ce sujet), ce qui va amplifier la crise financière des organismes HLM.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : habitat, logement, métropole, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 8 octobre 2021
A Grenoble nous avons de la chance de connaitre une expérience sociale originale, celle de l’association « Vivre aux Vignes » qui gère des appartements regroupés à services partagés (7 jours sur 7 et 24 heures sur 24) pour le maintien à domicile des personnes âgées dans leur propre logement et ce malgré parfois des handicaps lourds. C’est vraiment un exemple d’une alternative à l’EHPAD où les personnes sont hébergées mais ne sont pas des locataires de leur appartement. Cela fait partie de ce qui s’appelle, l’habitat inclusif.
Il serait important que la Métropole qui a la compétence habitat, le Département qui a la compétence d’aide aux personnes âgées et l’Etat décident d’un plan pour l’habitat inclusif dans notre agglomération, l’aide de l’association Vivre aux Vignes serait déterminante pour développer cette bonne idée dans les meilleures conditions.
Samedi 2 octobre se fêtait les 20 ans de cette belle expérience qui a exigé une détermination à toute épreuve de l’association Vivre aux Vignes qui regroupe les familles des locataires et de nombreux soutiens.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : logement, personnes âgées, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 8 octobre 2021
Le 4 octobre 2021, la cour des comptes rend public un rapport sur un premier bilan de la réforme du groupe Action Logement créé par une ordonnance de 2016.
La participation des employeurs à l’effort de construction (Peec) avait été instaurée en 1953 pour remédier à l’insuffisance de logements du fait des destructions de la deuxième guerre mondiale et de l’absence d’une politique en faveur du logement social dans l’entre-deux guerres (c’était le fameux 1% patronal). Ce prélèvement, établi à 0,45 % depuis 1991, représente aujourd’hui une contribution obligatoire de 1,7 Md€ imposée aux entreprises de plus de 50 salariés.
En 2016 il y a la création du groupe Action logement pour mettre fin à une organisation éclatée et insuffisamment contrôlée de la gestion de ce prélèvement. Action Logement contrôle plus de 50 filiales immobilières possédant près d’un million de logements – soit plus de 20 % du parc national de logements sociaux. C’est donc un opérateur de tout premier plan dans la gestion du logement social et est même devenu le financeur obligé notamment de l’ANRU.
Le relèvement par la loi Pacte de mai 2019 des seuils d’assujettissement aux entreprises comptant plus de cinquante salariés a abouti à ce que 80 % des entreprises de plus de dix salariés (représentant 40 % de l’ensemble des salariés) qui constituaient précédemment une part importante des entreprises contributrices, sont désormais extérieures au dispositif.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : état, logement, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 24 septembre 2021
Une programmation 2021 de logements sociaux dans l’agglomération trop faible :
Au Conseil de la Métro du 24 septembre, la délibération concernant la programmation des demandes d’agrément d’offre nouvelle de logement locatif social pour 2021 donne des chiffres qui sont insuffisants pour remplir les obligations du PLH (1300 logements sociaux par an). Cela rejoint une déprime nationale concernant le nombre de créations de logements sociaux. Or cette programmation verra les réalisations à intervenir au cours des années 2023-2025.
Voilà ce qui est prévu pour 2021 dans cette programmation :
« 969 logements ou équivalents logements locatifs sociaux :
- 737 logements locatifs sociaux familiaux, 466 PLUS, 269 PLAI et 2 PLS, dont 68 logements venant en reconstitution de l’offre démolie (agréés par l’ANRU) ;
- 192 logements locatifs sociaux spécifiques PLS : 3 projets de résidences étudiantes dont 2 sur Grenoble et une sur Gières, et un foyer d’accueil médicalisé (« FAM ») sur Saint Egrève.
- S’y ajoute un projet de Centre d’hébergement de réinsertion Sociale (CHRS) de 40 places sur Grenoble financé par du « Produit Spécifique Hébergement » (PSH), qui est assimilé au produit PLAI pour le financement apporté par la Métropole.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : logement, métropole, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 17 septembre 2021
L’INSEE présente une étude intitulée « Une personne sur cinq est en situation de pauvreté monétaire ou de privation matérielle et sociale ».
Pour définir la pauvreté, l’insuffisance de revenus n’est qu’un aspect, qui doit être complété par des indicateurs non monétaires reposant sur les conditions de vie. En 2019, en France métropolitaine, 13,1 % de la population est pauvre au sens non monétaire, selon l’indicateur européen de privation matérielle et sociale, 21,0 % est en situation de pauvreté monétaire ou de privation matérielle et sociale et 5,7 % cumule les deux. Les ménages dont la personne de référence est au chômage et les familles monoparentales sont particulièrement exposés au risque de pauvreté : respectivement 50,8 % et 29,2 % sont pauvres au sens de la privation matérielle et sociale ; 33,3 % et 14,1 % cumulent cette privation avec une pauvreté au sens monétaire.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : insee, précarité, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 17 septembre 2021
Amnesty international publie le 14 septembre une enquête sur des violences policières lors d’une free-party à Redon. Bilan humain : un jeune homme a eu la main arrachée, des gendarmes et des dizaines de participants ont été blessés. Enquête.
Le Parc Cambridge sur la presqu’île de Grenoble est en cours de création : un hectare de fraîcheur, de loisir, de convivialité et de nature. Il est réalisé par la SEM Innovia en collaboration avec la ville. Rappel, sur la Presqu’île il y a 580 logements familiaux, 380 logements étudiants et 11 commerces ; 200 logements sont en construction et 120 sont en prévision.
Situation et perspectives du logement social. Etude de la banque des territoires (Caisse des dépôts et consignations). Vision trop optimiste d’une banque très engagée dans ce secteur et qui présente toujours une vision positive de la situation d’un secteur pourtant très touché par les mesures gouvernementales.
Veut-on se débarrasser des algues vertes ? Un rapport de la Cour des comptes dresse un bilan sévère de l’action publique pour lutter contre la prolifération des algues vertes sur les côtes bretonnes. La réponse, pourtant, est simple : traiter pour de vrai le mal à la racine !
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : justice, logement, police, social, Urbanisme
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 11 septembre 2021
Les salariés de la société Cykléo qui gère l’exploitation du service Métrovélo pour le compte du SMMAG sont en grève depuis le 7 septembre.
Cykléo gère ce service dans le cadre du marché public n°2019-673 « Exploitation du service de location vélo et de consignes METROVELO », conclu pour une durée de 4 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, suivant une délibération de la Métropole du 27 septembre 2019. Puis ce marché a été transféré au SMMAG en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité en 2020.
L’explosion de l’utilisation du vélo (presque 10 000 Métrovélos) n’a pas été anticipée par Cykléo, ni par le président du SMMAG. Les personnels (38 salariés) se plaignent de la dégradation constante des conditions de travail, d’un manque de moyens humains et matériels, d’un dialogue social déficient, de nouveaux logiciels défaillants et mettant en danger la continuité du service public et la satisfaction des usagers. Il n’y a pas assez de mécanicien pour réparer les 1400 vélos en attente. Le logiciel de location n’est pas adapté à la quantité de demandes…
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Déplacements, métropole, Mobilisations, modes actifs, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 11 septembre 2021
Un décret du 30 août précise l’essentiel de la réforme des modes d’accueil de la petite enfance, en préparation depuis près de deux ans et annoncée par l’ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles. Le gouvernement fait régresser la qualité de l’accueil et des conditions de travail dans ce secteur.
Le décret traite notamment des obligations des assistantes maternelles en matière de déclaration de leurs places disponibles, des traitements et soins médicaux des enfants pris en charge par des professionnels d’un mode d’accueil du jeune enfant, de la réglementation commune aux établissements d’accueil du jeune enfant et des crèches collectives.
Cette réforme a fait réagir fortement « Pas de bébés à la consigne » regroupement de très nombreuses associations, syndicats et professionnels de la petite enfance, qui milite pour une politique publique ambitieuse pour la petite enfance permettant aux familles qui le souhaitent d’accéder à un mode d’accueil de qualité sans barrière financière, car c’est la première condition pour assurer le droit au travail des femmes.
Il faut souhaiter que les collectivités locales résistent à certaines dispositions, qui peuvent dégrader fortement la qualité du service, notamment sur l’encadrement des enfants. Elles devront mettre en place des supervisions des équipes de crèche ce qui est positif et l’inscription de la charte petite enfance qui peut devenir une bonne base pour travailler le projet pédagogique des crèches municipales.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : enfance, état, Mobilisations, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 3 septembre 2021
Alors que la politique gouvernementale a porté un violent coup contre le logement social en imposant la réduction du loyer de solidarité (RLS), c‘est à dire en attaquant directement les recettes des bailleurs sociaux avec pour conséquence une grande difficulté pour beaucoup de poursuivre des programmes de construction car ces derniers ont besoin pour construire sans trop s’endetter d’apports importants en fonds propres qui ont alors fortement diminués. Les bailleurs les plus touchés sont ceux qui sont fortement présents dans les QPV, comme ACTIS.
Parallèlement la crise sanitaire a donné un coup d’arrêt à la construction de logements en général. Dans l’agglomération grenobloise les programmes de construction ont du mal à se développer et dans de nombreuses communes, dont la ville-centre, les perspectives indiquées dans le Programme Local de l’Habitat (PLH) sont loin d’être suivies.
A Grenoble, le foncier devient rare et est de plus en plus cher, il va falloir relancer de manière très active la construction de logements sociaux si on veut atteindre les 25 % en 2025. Heureusement que le PLU corrigé en 2014 puis le PLUi ont augmenté le taux de logements sociaux dans les opérations de construction.
Pour aider cette politique il faudrait que nationalement, le gouvernement change de politique.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : habitat, logement, métropole, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 28 août 2021
L’INSEE vient d’éditer pour l’année 2020 la liste des équipements de services aux particuliers dans chaque quartier IRIS des communes dont Grenoble.
En 2020, la Base Permanente des Équipements se compose de 188 types d’équipements répartis en 7 grands domaines : services aux particuliers ; commerces ; enseignement ; santé ; transports et déplacements ; sports, loisirs et culture ; tourisme.
Les équipements sont répartis suivant trois gammes : proximité, intermédiaire et supérieure.
Tous les détails se trouvent sur le site de l’INSEE.
Dans le tableau suivant seuls 6 domaines sont indiqués : services d’action sociale ; fonctions médicales et paramédicales ; services santé ; services aux particuliers ; sport, loisirs et culture ; commerces.
Pour les domaines du tourisme et transports ; enseignement du 1er degré ; du 2ème degré ; du supérieur et des formations et services de l’éducation, les chiffres se trouvent sur le site de l’INSEE.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : commerce, insee, services publics, social, solidarité
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 28 août 2021
Un guide pratique concernant la publication en ligne des données publiques. La CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) et la CNIL (Commission nationale informatique et libertés), viennent d’éditer un « GUIDE PRATIQUE DE LA PUBLICATION EN LIGNE ET DE LA RÉUTILISATION DES DONNÉES PUBLIQUES (« OPEN DATA ») »
Coût social du bruit en France. Une étude de l’ADEME estime le coût social du bruit en France et analyse de mesures d’évitement simultané du coût social du bruit et de la pollution de l’air. Le coût social du bruit en France est estimé à 155,7 milliards d’euros par an. La majorité (68%) de ce coût est liée aux transports : le bruit routier représente 52% des coûts, le bruit aérien 9% et le bruit ferroviaire 7%.
Le Haut Conseil de la santé publique rend différentes recommandations sur la gestion des épisodes de canicule extrême, sur la protection des populations par l’iode stable en cas d’accident nucléaire, sur le dépistage du Covid en milieu scolaire et sur les effets de l’exposition des enfants et des jeunes aux écrans.
Aux Etats-Unis, la justice confirme que le Roundup cause des cancers. C’est un nouveau revers pour Bayer qui fait face à des milliers de poursuites judiciaires aux Etats-Unis. Le géant allemand a perdu un appel en justice contre une décision statuant que son désherbant Roundup provoquait des cancers.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : bruit, CNIL, pollution, santé, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 16 juillet 2021
Lors du Conseil municipal de Grenoble du 12 juillet a été approuvé le principe de création d’une Société anonyme de coordination (SAC) comprenant les deux organismes ACTIS et Grenoble Habitat, pour constituer les outils métropolitains de construction, réhabilitation et gestion locative et conserver ACTIS sous contrôle politique de la métropole. Cette délibération rejoint celle du Conseil de métropole du 21 mai 2021.
Cette décision est indispensable, suite aux décisions gouvernementales qui mettent à mal les bailleurs sociaux en les étranglant financièrement et en les obligeant à se restructurer en construisant des ensembles plus importants. Et l’outil à mettre en place sera mobilisé pour remplir les exigences du Programme Local de l’Habitat (PLH 2017-2022) auquel le préfet apporte une grande attention et sans doute une grande surveillance. Il y a déjà 8 communes qui sont carencées (deux de plus que l’an passé) et qui doivent payer une « amende » à la Métro pour insuffisance de construction de logement social.
Rappelons comment fonctionnent financièrement les organismes HLM.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : grenoble, logement, métropole, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |