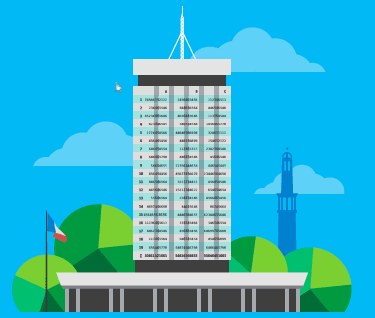Archives pour le mot-clef ‘Education’
Publié le 17 novembre 2022
Le 9 novembre 202, le ministre de l’Education Nationale a transmis aux recteurs et rectrices une circulaire précisant les actions à mener pour mieux lutter contre les atteintes au principe de laïcité dans les établissements scolaires, dans un contexte de hausse des signalements. On est passé de 313 signalements en septembre à 720 en octobre 2022, le port des tenues à connotation religieuse représentant 40% des faits signalés.
La circulaire entend renforcer le respect de la laïcité à l’école en proposant de sanctionner systématiquement et de façon graduée le comportement des élèves, de renforcer la protection et le soutien aux personnels, d’appuyer les chefs d’établissement en cas d’atteinte à la laïcité, et de renforcer la formation des personnels.
Voici l’introduction de la circulaire :
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Education, laïcité
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 28 octobre 2022
La Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l’Education nationale et de la jeunesse, rend publique les premiers résultats du Baromètre du bien-être au travail des personnels de l’Éducation nationale exerçant en établissement scolaire.
Le baromètre repose sur l’interrogation de 62 000 personnels de l’éducation nationale exerçant en école et en établissement scolaire. Leur satisfaction professionnelle est inférieure à la moyenne des Français en emploi. Ils sont cependant à des niveaux de satisfaction proches des Français concernant la vie menée actuellement et le sentiment que leur vie personnelle et professionnelle a du sens et de la valeur pour eux.
Les perspectives de carrière (3,1 sur 10) et leur niveau de rémunération (3,4 sur 10) sont jugés globalement insatisfaisants par les personnels de l’Éducation nationale. La moitié d’entre eux signalent un sentiment d’épuisement professionnel élevé. Leur satisfaction concernant l’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle est cependant proche de celle des Français en emploi (5,7 sur 10 contre 6,2).
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Education, personnel, santé
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 28 octobre 2022
Éducation populaire : un nouveau partenariat entre la Ville et les associations. La ville de Grenoble accorde une place de choix aux acteurs de l’éducation populaire et notamment les centres de loisirs qui réalisent un travail important d’éducation, de soutien aux parents et d’ouverture au monde pour les enfants et adolescent-es. Pour améliorer encore cet accueil et pousser ses ambitions, 4 grandes priorités politiques ont été fixées pour les 5 prochaines années.
La France se retire du traité de la charte sur l’énergie (TCE). La mobilisation de longue date contre le TCE, accord d’investissement néfaste et climaticide, a porté ses fruits. La pression ne cessait de s’accroître sur la France, Macron a annoncé la sortie du pays du Traité sur la charte de l’énergie. Un texte qui freine la transition énergétique européenne. L’Espagne, les Pays-Bas et la Pologne ont déjà annoncé leur retrait du texte. Le TCE, signé en 1994 par l’Europe et les pays de l’ancien bloc soviétique, donne aux investisseurs la possibilité d’attaquer les gouvernements qui modifieraient leur politique énergétique. Un vrai risque pour l’Union européenne en pleine transition bas-carbone.
Un peu de répit pour le Lagopède alpin : sa chasse suspendue dans le massif de Belledonne. À la demande de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, le tribunal administratif de Grenoble a suspendu à compter de ce 26 octobre la chasse du Lagopède alpin sur 6 communes du massif de Belledonne où elle avait été autorisée par le préfet de l’Isère. La juridiction s’appuie sur le dernier bilan décennal de l’observatoire des galliformes de montagne (OGM) qui souligne que « les résultats récents, issus des suivis par radiopistage, suggèrent que le plus souvent la fécondité des populations de lagopède alpin n’est pas suffisante pour compenser la mortalité naturelle« .
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : alerte, écologie, Education, Energie
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 2 septembre 2022
Rentrée scolaire 2022-2023 à Grenoble. La rentrée 2021-2022 a été marquée par une forte baisse des effectifs avec près de 450 élèves de moins, soit plus de 3,5 % de baisse. Pour la rentrée 2022-2023, cette diminution devrait se poursuivre : 11 600 élèves sont attendus, soit environ 315 élèves de moins (2,6%). Les naissances connaissant une diminution notable et continue depuis plusieurs années. Poursuite du projet Place(s) aux Enfants et de la transformation des cours d’école ; une réorganisation importante du périscolaire municipal ; un taux de couverture d’ATSEM par classe de 100% .
Arrestation et garde à vue président de Vivre et Agir en Maurienne. Philippe Delhomme coprésident de Vivre et Agir en Maurienne association de protection de l’environnement a été interpellé sur un barrage contre le bétonnage et l’assèchement de la Maurienne pour le projet Lyon-Turin. Pendant que le gouvernement déclare que l’eau est un problème national et européen, qu’il faut la préserver, le préfet fait arrêter et mettre en garde à vue un protecteur de l’environnement qui se bat depuis des années pour sauvegarder ce bien essentiel à la vie ! Voir le reportage France 3 sur ce lien.
Éducation : donner la priorité aux perdants. Les inégalités scolaires ne se sont pas réduites mais déplacées. Résultat : les vaincus du système scolaire se défient des valeurs démocratiques. Il faut repenser l’école pour éduquer à la confiance en soi, à la solidarité et à la tolérance, sans humilier personne. Les propositions du sociologue François Dubet à lire dans la lettre de l’Observatoire des inégalités : Éducation : donner la priorité aux perdants
L’accompagnement humain des élèves en situation de handicap. Rapport de la Défenseure des droits consacré à l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap. Les résultats quantitatifs sont plutôt positifs ces dernières années. Elle déplore une inadéquation entre les moyens mis en œuvre et les véritables besoins des élèves.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Education, handicap, numérique, répression
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 1 juillet 2022
Le projet éducatif a été présenté au conseil municipal du 27 juin par les adjointes au maire Christine Garnier, Annabelle Bretton, par l’adjoint vice-président du CCAS Nicolas Kada et par la conseillère déléguée Sylvie Fougère.
Christine Garnier et Annabelle Bretton ont également présenté une convention relative au projet éducatif de territoire, pour la période 2022-2025 labellisé « Plan mercredi ».
Projet éducatif :
La Ville et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont élaboré un projet éducatif global (2022- 2027) qui doit permettre l’accès à un parcours éducatif de qualité pour chaque enfant, jeune et adulte grenoblois-e. En plaçant la lutte contre les inégalités au centre des actions menées, la Ville et son CCAS ambitionnent justement que chacun-e puisse jouir de l’ensemble de ses droits, dans un contexte d’urgence climatique qui nécessite de repenser le rapport de toutes et tous à la planète.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : conseil municipal, Education, enfance, grenoble, social
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 24 juin 2022
Un décret anéantit le statut des professeurs de Lycée Professionnels. C’est pourtant la voie choisie par beaucoup de jeunes des classes populaires. C’est la suite logique de la casse de l’enseignement professionnel sous statut scolaire démarrée par Blanquer. Derrière le boum de l’apprentissage, une évolution souhaitée par tous les lobbys patronaux, une main-d’œuvre gratuite ou quasi-gratuite pour les employeurs. C’est l’État qui paie la première année du contrat d’apprentissage, avec des primes de 5 000 et 8 000 €. Pour comprendre ce qui se passe lire ici.
Santé : l’urgence d’agir. L’association des maires de France (AMF) s’alarme des fermetures totales ou partielles des services d’urgences constatées sur l’ensemble du territoire national (120 au niveau national). Pour l’AMF, c’est tout le système de santé qu’il faut réinterroger, la crise des urgences n’étant qu’un symptôme. L’AMF plaide pour un renforcement des liens entre la médecine de ville et la médecine hospitalière.
Sécurité des ponts : en attendant la catastrophe…Trois ans après l’appel du Sénat à un « plan Marshall » pour sécuriser les ponts, un nouveau rapport sénatorial estime que le compte n’y est pas et que la dégradation des ponts se poursuit, sans que l’État accepte pour l’instant de mettre les moyens nécessaires. La synthèse du rapport est publiée en attendant le rapport complet.
Le système FR-Alert est déployé depuis le 22 juin : FR-Alert, est le nouveau dispositif d’alerte des populations par le biais de téléphones portables. Il s’agit d’une obligation décidée à l’échelle européenne. Toute personne se trouvant dans une zone concernée par un danger imminent (catastrophe climatique, accident industriel, attaque terroriste…) recevra un message sans avoir eu à télécharger préalablement une application et sera informé sur la nature du risque, sa localisation et sur les comportements à adopter pour se protéger.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : drogues, Education, santé, Sécurité
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 10 juin 2022
Les élues et élus des villes éducatrices s’inquiètent du démantèlement de l’Éducation Nationale dans un communiqué du 7 juin. « À la suite de nombreux acteurs de l’éducation (si ce n’est l’ensemble), les élues et élus du Réseau français des villes éducatrices s’alarment une nouvelle fois du démantèlement en cours de l’Éducation Nationale. Cette destruction a atteint son paroxysme avec le triste symbole du job-dating organisé par l’Académie de Versailles : recruter en trente minutes des contractuels pour « boucher les trous » là où les professeurs et enseignants formés manquent…
La fourniture de services publics fonctionnels nécessite une vraie volonté politique. Tous les enfants du territoire méritent d’avoir accès à une éducation publique de qualité. Cela passe par des enseignants formés, rémunérés correctement et non précaires. »
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Education, état
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 3 juin 2022
Un rapport récent de l’Inspection Générale de l’éducation du sport et de la recherche (IGESR) sur l’illettrisme demande une vraie mobilisation de l’éducation nationale. Longtemps sous-estimé, l’illettrisme apparaît désormais au grand jour à la faveur d’indicateurs robustes et convergents. Au-delà des données statistiques, il correspond à une réalité contrastée et complexe que l’on observe y compris dans des formes très contemporaines.
La prise en charge de l’illettrisme, retardée ou négligée pour des raisons diverses, notamment au sein de l’éducation nationale, demeure un sujet brûlant.
Sur la base d’un état des lieux, le rapport propose des stratégies pour une meilleure coordination des modalités de prise en charge déjà existantes.
Ce texte de la « mission prospective sur l’illettrisme » est éclairant sur les raisons de cette situation que nous connaissons à Grenoble principalement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficiant des réseaux d’éducation prioritaire.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Education
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 27 mai 2022
Le ministère de l’Éducation nationale vient enfin de publier le rapport de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche qui datait de juillet 2021, intitulé : « Les phénomènes de communautarisme au sein des associations sportives et de jeunesse, dans les accueils collectifs de mineurs ou les autres structures d’accueil de jeunes »
Ce rapport examine des manifestations qui menacent les principes républicains (notamment la laïcité et l’égalité entre les hommes et les femmes), se traduisent par des manifestations de repli sur soi identitaire ou peuvent conduire à des tentatives de prosélytisme, voire de pressions sur les individus, principalement envers les enfants et les jeunes.
« Après avoir réalisé un rapide tour d’horizon des différentes évolutions (socio-économiques et urbaines, religieuses, administratives et politiques, juridiques) pouvant expliquer le développement de ces phénomènes dans les mouvements de jeunesse, les associations ou les clubs et les fédérations sportives ou d’éducation populaire, la mission d’inspection générale fait le point sur les différentes mesures prises depuis 2014. Elle note les progrès réalisés pour développer une culture de la vigilance et les actions de contrôle, mais aussi certaines limites, notamment pour sensibiliser les nombreux acteurs de terrain et pour connaître ou signaler les difficultés rencontrées dans les structures, associations et clubs locaux.
Dans une dernière partie, la mission émet des propositions en matière de signalement, de contrôle, d’offre éducative, de formation et de dispositions législatives et réglementaires. Elle invite à évaluer les risques encourus à leur juste mesure, sans les minorer ou les exagérer, et à mener un large débat politique et citoyen en vue d’apporter une réponse commune à ce qui menace les principes républicains et le vivre-ensemble. »
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Education, jeunesse, sports
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 21 mai 2022
De larges partie du territoire menacée par la sécheresse. L’épisode de chaleur accentue les inquiétudes sur les risques de sécheresse d’ici à la fin de l’été. Dans une carte que vient de publier le gouvernement, 22 départements apparaissent déjà en rose foncé. La France a connu, avec 38 jours consécutifs, l’une des plus longues périodes de chaleur au printemps. Le gouvernement a publié ce 18 mai une carte des territoires avec risque de sécheresse d’ici la fin de l’été. CASH_carte_18052022-1.pdf (ecologie.gouv.fr)
Évaluation nationale des cités éducatives Premiers enseignements sur l’appropriation du programme en matière de continuité éducative, d’orientation-insertion et de place des familles. Rapport réalisé par l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) mai 2022. Près de deux années scolaires après leur mise en place, les cités éducatives n’ont pas encore prouvé leur plus-value, selon une note de l’Injep. En cause : un flou conceptuel et des partenariats inaboutis. rapport-2022-10-Cites-educatives.pdf (injep.fr)
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : climat, commerce, Eau, Education, élections, logement, Urbanisme
Publié dans Eau, Politique |
Publié le 6 mai 2022
Pourquoi supprimer des autoroutes peut réduire les embouteillages ? En effet cela entraînerait « une évaporation du trafic » (c’est le trafic dit « déduit » ou « évaporé »). Est-ce bien sérieux ? Par quel prodige pourrait-on faire naître de tels effets ? Ces phénomènes sont pourtant scientifiquement fondés et abondamment documentés. Mais de nombreux élus et professionnels ne l’admettent toujours pas, limitant ainsi leur capacité à adapter nos villes aux exigences sociétales et environnementales du XXIe siècle. Lire l’article dans The Conversation.
Semaine de l’éducation Quel enfant en 2030 ? Aider les enfants à bien grandir, préparer l’écocitoyen-ne de demain, tels sont les deux piliers de la semaine de l’éducation qui se tient à Grenoble du 9 au 14 mai 2022. Conférences, ateliers et tables rondes : autant d’échanges ouverts à la communauté éducative, des professionnel-les de l’éducation aux parents, pour réfléchir ensemble. Objectif ? donner aux jeunes grenoblois-es les clés pour grandir sereinement et acquérir ce qui les aidera à devenir des citoyens et citoyennes émancipées, résilient-es face aux crises et solidaires du monde qui les entoure. Cette semaine de l’éducation ouverte à toutes et à tous intervient dans un moment de redéfinition du Projet éducatif de Grenoble pour ses jeunes habitant-es et leurs familles et enrichira la réflexion de la Ville et de son CCAS.
Changement important dans les critères de la commande publique. Un décret précise que l’acheteur public devra appliquer : soit le critère unique du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre ; soit une pluralité de critères parmi lesquels figurent le prix ou le coût. Au moins l’un d’entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Ces critères peuvent également comprendre des aspects qualitatifs ou sociaux.
Vente de documents déclassés de la bibliothèque municipale. Comme chaque année, la bibliothèque municipale de Grenoble met en vente des livres à bas prix pour leur offrir une seconde vie. Cette vente n’ayant pas pu avoir lieu en 2020 et 2021 à cause de la crise sanitaire, un important volume de livres est proposé à la vente qui se tient sur trois jours, du 5 au 7 mai, à l’ancien musée de peinture.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Déplacements, Education, lecture publique, marchés, public-privé
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 1 avril 2022
Portée par les adjointes au maire Elisa Martin et Christine Garnier, une délibération sur une nouvelle cité éducative a été adoptée et un conventionnement avec l’Etat va permettre à la ville de recevoir une aide financière de 450 000 € par an pour la période 2022-2024.
Anne-Sophie Olmos quant à elle a présenté une délibération sur la démocratie coopérative qui va permettre aux habitants bénévoles de participer à des actions avec les services de la ville en s’engageant dans un pacte qui autorisera cette coopération
Une nouvelle cité éducative.
Après 2 ans de fonctionnement de la cité éducative Grenoble/Échirolles, l’ensemble des partenaires ont fait état d’avancées significatives en termes de dynamique éducative, de partenariat institutionnel et opérationnel, de cohérence et de renforcement des prises en charges éducatives. Les villes de Grenoble et d’Échirolles ont pu déposer un dossier de candidature et ont proposé de dédoubler la cité éducative Grenoble/Échirolles afin de créer deux nouvelles cités éducatives correspondant à leurs périmètres communaux respectifs.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : conseil municipal, démocratie locale, Education, grenoble
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 25 mars 2022
Selon une note d’information de la Depp (Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance), n° 22.11 de mars 2022, le nombre d’élèves dans le premier degré s’établirait à 6 462 000 à la rentrée 2022, en baisse de 76 600 élèves après une diminution de 78 300 élèves observée entre les rentrées 2020 et 2021.
La baisse des effectifs se poursuivrait dans les années à venir, à la fois dans le niveau préélémentaire et dans le niveau élémentaire. Cette prévision résulte essentiellement des évolutions démographiques, avec des générations d’élèves de moins en moins nombreuses.
Ceci aura des conséquences non négligeables pour les politiques municipales actuelles concernant les constructions ou rénovations des écoles. Il est toujours très difficile de prévoir ces évolutions au niveau d’une commune, cela dépend de l’évolution démographique dans chaque quartier.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Education, france
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 25 février 2022
Pesticides : c’est dans l’air ! Quelle dérive des pesticides et quelle efficacité réelle d’une Zone Non Traitée de 10 mètres ? C’est le titre d’un rapport de l’ONG Générations futures du 22 février, qui pointe à nouveau l’insuffisance des distances de sécurité près des habitations. L’efficacité des zones de non traitement (ZNT) – de 5 et 10 mètres – pour réduire l’exposition des riverains aux pesticides pulvérisés en agriculture est à nouveau remise en question.
Transition(s) 2050. Choisir maintenant. Agir pour le climat. C’est le titre d’une étude de l’Agence de la transition écologique (ADEME) qui propose 4 scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050, chacun explorant des transformations différentes sur des dimensions techniques, économiques, de société, de gouvernance et de territoires.
Un bilan du quinquennat en matière éducative. A été réalisé par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat. Le rapport conclut que de nombreux objectifs n’ont pas été atteints, conduisant à un sentiment de naviguer à vue et de « générations d’élèves cobayes ». Des réformes précipitées dont la mise en œuvre a été mal accompagnée.
Manque d’activité physique et excès de sédentarité : une priorité de santé publique. C’est ce qu’indique un avis rendu public le 15 février par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) relatif à l’évaluation des risques liés aux niveaux d’activité physique et de sédentarité des adultes de 18 à 64 ans. 95% de la population française adulte est exposée à un risque de détérioration de la santé par manque d’activité physique ou un temps trop long passé assis. Ces risques sont majorés lorsque le manque d’activité physique et l’excès de sédentarité sont cumulés. Promouvoir des modes de vie favorables à la pratique d’activités physiques et à la lutte contre la sédentarité doit constituer une priorité des pouvoirs publics.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : climat, Education, pesticides, santé
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 29 janvier 2022
Les chiffres du dernier recensement (2018) concernant la population scolarisée dans les différents quartiers IRIS de Grenoble montrent d’importantes disparités.
A Grenoble, sur les 50 000 scolarisés, il y a 10 % des effectifs de 2 à 5 ans ; 15% de 6 à 10 ans ; 12% de 11 à 14 ans ; 8 % de 15 à 17 ans et plus de la moitié (54%) pour les plus de 17 ans. Ces ratios n’ont pas beaucoup évolué depuis 5 ans.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Education, grenoble, inégalités, insee, population
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 17 décembre 2021
A l’occasion de l’anniversaire de la promulgation de la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat, JL Bianco ancien président de l’Observatoire de la laïcité, supprimé par le gouvernement, a rappelé l’histoire du concept de laïcité de séparation des églises et de l’Etat.
D’un point de vue idéologique, il existe deux conceptions dominantes de la laïcité.
Celle d’Aristide Briand, rapporteur de la loi 1905 soutenue par Jaurès puis par Clémenceau, c’est une laïcité de la liberté. Elle n’exclut pas d’être vigilant à l’égard de tous ceux qui tenteraient d’imposer une loi religieuse au-dessus des lois de la République. Comme le disait si bien Jaurès, « la loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne veut pas faire la loi ».
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Education, état, laïcité
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 10 décembre 2021
Elus locaux, les droits à la formation. Un guide pratique pour comprendre publié par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Ce guide a pour objectif de recenser les informations pour bénéficier de ces formations. Deux types de formations existent : celles qui ont pour but d’accompagner les élus « dans l’exercice de leurs fonctions électives », et celles qui permettent de faciliter la réinsertion professionnelle.
Sexisme en politique. Le réseau Élues locales a dévoilé une étude qui révèle que 74 % des femmes politiques locales subissent du sexisme voire des violences dans l’exercice de leurs fonctions. Environ 1000 femmes ont été interrogées. Ces femmes ont été élues à 81 % à l’échelle d’une commune, 10 % d’une intercommunalité, 3,5 % d’un département, 3 % d’un niveau national et 2,5% d’une région. Des collectivités de toute taille ont donc été prises en compte.
Regard financier sur les départements. C’est le titre d’une étude de la Banque Postale, réalisée en partenariat avec l’Assemblée des Départements de France (ADF). Elle analyse les finances départementales de 2001 à 2021, plus particulièrement le dernier mandat ainsi que l’influence de l’épidémie de Covid-19.
La gestion des absences des enseignants. C’est le titre du rapport du 2 décembre 2021 rendu par la Cour des comptes qui souligne que ces absences, loin de constituer un phénomène global, recouvrent en réalité deux catégories bien distinctes : les absences pour motifs personnels (liées notamment à la santé), et celles relevant de l’organisation scolaire elle-même (formation continue, examens, sorties scolaires…). La Cour des comptes formule six recommandations visant à mieux appréhender le phénomène, à améliorer la prévention en matière de santé, et à limiter et compenser les absences de courte durée.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : conseil départemental, droits des femmes, Education, élu
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 29 octobre 2021
Les Places aux enfants autour des écoles de Grenoble vont se poursuivre, malgré l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble rendue le 22 octobre 2021 qui suspend l’arrêté du maire du 7 juillet 2021 portant organisation générale du projet de piétonisation dénommé Place(s) aux Enfants. En effet le maire a pris un nouvel arrêté qui prend en compte les raisons de la suspension par le juge
Voici un résumé de l’ordonnance : « Le juge des référés a considéré que l’objectif de sécurité publique consistant à protéger les enfants de la circulation automobile devant les écoles, ainsi que celui visant à limiter la pollution de l’air, étaient justifiés.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : Déplacements, Education, justice administrative, Sécurité
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |
Publié le 8 octobre 2021
Le bruit détruit plus la santé que la pollution de l’air. Des dégâts totalement ignorés par les autorités. Un rapport réalisé par le Conseil national du bruit et l’Agence de la transition écologique (Ademe), en donne la mesure. Selon ce document, le « coût social du bruit » en France est de 155,7 milliards d’euros annuels. Une somme astronomique, supérieure à ce que coûte la pollution atmosphérique
Élèves transgenres à l’école : une circulaire du ministère de l’Education nationale. Du 30 septembre, qui donne les lignes directrices à l’ensemble de la communauté éducative pour mieux accompagner les élèves transgenres à l’école.
La note de conjoncture de la Banque Postale sur les finances locales. Il y a du mieux, il y a aussi recours à l’augmentation d’impôts par certains EPCI et il y a quelques inquiétudes sur le montant des investissements futurs vu les difficultés d’approvisionnement en matières premières, la hausse du prix de l’énergie et la croissance rapide des prix dans le bâtiment et les travaux publics.
Qui sont les ménages en précarité énergétique dans les copropriétés ? Une étude de l’Observatoire National de la Précarité Energétique (ONPE) sur le public du parc privé, hors monopropriétés.
Lire le reste de cet article »
Mots-clefs : discriminations, écologie, Education, FInances, santé
Publié dans Le Rouge & le Vert Hebdo, Politique |